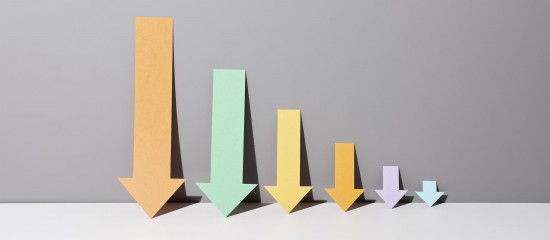Crée le 27-02-2026
Un professionnel peut-il bénéficier des règles protectrices du démarchage à domicile ?
JuridiqueAutresContratsJurisprudenceLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoActualitéUn artisan bénéficie de la réglementation sur le démarchage à domicile lorsqu’il souscrit à distance un contrat de location de matériel de vidéosurveillance pour son local professionnel.
Christophe Pitaud
Lorsqu’un professionnel souscrit un contrat avec un autre professionnel en dehors de l’établissement de ce dernier (par exemple, à distance ou dans ses propres locaux), il bénéficie des règles de protection sur le démarchage à domicile applicables aux consommateurs, dès lors que :- le contrat est sans rapport direct avec son activité professionnelle (pour les contrats conclus avant le 17 mars 2014) ;- l’objet de ce contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale et qu’il n’emploie pas plus de 5 salariés (pour les contrats conclus depuis le 17 mars 2014).
Ainsi, dans une affaire récente, les juges ont considéré qu’un contrat de location de matériel de vidéosurveillance, souscrit hors établissement (en l’occurrence dans ses propres locaux) par un artisan chocolatier, était « sans rapport direct avec son activité professionnelle » (ce contrat avait été signé en 2011) bien qu’il ait été destiné à protéger son local professionnel. Et donc que cet artisan était en droit de faire annuler ce contrat dès lors qu’il avait été conclu en violation des règles du droit de la consommation (la décision de justice ne précise pas la nature des règles qui n’avaient pas été respectées).
Précision : : rendue à propos d’un contrat conclu avant le 17 mars 2014, date à laquelle la réglementation avait évolué, cette décision aurait vraisemblablement été la même pour un contrat conclu après cette date (contrat n’entrant pas dans le champ de son activité principale de chocolatier).

Crée le 27-02-2026
Participation aux résultats de l’entreprise : quel bénéfice net retenir ?
SocialRémunérationLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoAssociationsActualitéLa liste des bénéfices exonérés fiscalement qui doivent être pris en compte dans le calcul de la réserve spéciale de participation est allongée.
Coralie Carolus
Les employeurs d’au moins 50 salariés ont l’obligation d’instaurer un dispositif de participation aux résultats de l’entreprise en faveur de leurs salariés. À ce titre ils doivent, chaque année, calculer la « réserve spéciale de participation », autrement dit le montant des bénéfices à distribuer aux salariés. Et le calcul de celle-ci, qui est strictement encadré par la loi, dépend du bénéfice net de l’entreprise, de ses capitaux propres, de sa valeur ajoutée et des salaires. S’agissant du bénéfice net à retenir, il convient de neutraliser (et donc de réintégrer) certaines exonérations fiscales. Des exonérations dont la liste a récemment été allongée.
Le bénéfice de l’entreprise retenu pour calculer la réserve spéciale de participation correspond au bénéfice imposé à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, diminué de cet impôt. Et il convient d’y ajouter certains bénéfices qui font l’objet d’une exonération fiscale comme celle accordée aux jeunes entreprises innovantes ou au titre des activités créées dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE).
Depuis le 1 janvier 2026, doivent aussi être réintégrés dans le calcul de la réserve spéciale de participation, les bénéfices exonérés en raison de régimes fiscaux spécifiques applicables au titre :- des activités créées ou reprises dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville (en vigueur depuis le 1 janvier 2026 en remplacement de l’exonération ZFU-TE) ;- des activités créées dans des bassins d’emploi à redynamiser ;- des activités créées dans des zones de restructuration de la défense ;- de certaines exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte (zones franches d’activité) ;- des entreprises créées ou reprises dans des zones de revitalisation rurale et des zones France ruralités revitalisation ;- des entreprises créées dans des bassins urbains à dynamiser ;- des entreprises créées dans des zones de développement prioritaire.
Précision : : pour calculer la réserve spéciale de participation, les employeurs peuvent recourir à une formule dérogatoire spécifique à leur entreprise, à condition qu’elle soit aussi favorable aux salariés que la formule légale.

Crée le 26-02-2026
Les plafonds 2026 du Plan d’épargne retraite
PatrimoinePlacementLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoInstagramActualitéRevalorisé au 1 janvier 2026, le plafond annuel de la Sécurité sociale permet de calculer les déductions fiscales minimales et maximales pour les versements réalisés en 2026 sur les Plans d’épargne retraite.
Fabrice Gomez
Créé par la loi Pacte du 22 mai 2019, le Plan d’épargne retraite (PER) a pour vocation première de permettre à son souscripteur de se constituer, de manière très souple, une épargne dont il pourra profiter le jour de son départ en retraite.
En pratique, le PER peut être souscrit de manière volontaire et par tout un chacun. Pour se constituer un capital, l’assuré peut, pendant son activité, alimenter son PER en toute liberté par des versements ponctuels et/ou des versements réguliers selon la périodicité choisie (mensuelle, trimestrielle, annuelle).
Pour encourager les Français à se constituer une épargne retraite supplémentaire, le régime fiscal attaché au PER se veut incitatif. Ainsi, les versements sur un PER peuvent être déduits des revenus imposables de l’assuré (sauf option contraire). Mais il existe des limites à cette déduction. Des limites matérialisées par les plafonds de l’épargne retraite.
Au niveau de l’assuré, ces limites sont calculées, chaque année, par l’administration fiscale et indiquées sur son avis d’imposition. Concrètement, les plafonds de l’épargne retraite sont calculés selon une formule qui tient compte notamment du plafond annuel de la Sécurité sociale. Plafond qui, dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, a fait l’objet d’une revalorisation au 1 janvier 2026.
Ainsi, la déduction à l’entrée est plafonnée, pour les travailleurs non-salariés, à :- 10 % du bénéfice imposable, limité à 8 Pass (plafond annuel de la Sécurité sociale) augmenté de 15 % du bénéfice compris entre 1 et 8 Pass, soit 88 911 € maximum au titre de 2026 ;- ou 10 % du Pass, soit 4 806 €.
Pour les versements effectués par les particuliers (salariés...), les versements volontaires sont déductibles dans la limite égale au plus élevé des deux montants suivants :- 10 % des revenus professionnels dans la limite de 8 Pass (N-1), soit 37 680 € en 2026 ;- ou 10 % du Pass (N-1), soit 4 710 €.
Précision : : une fois ces plafonds « fiscaux » atteints, rien n’empêche l’assuré de verser au-delà de ces derniers.

Crée le 25-02-2026
Frais de carburant : les nouveaux barèmes en baisse !
FiscalFiscalité professionnelleFiscalité des résultatsLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoActualitéComme chaque année, l’administration fiscale a publié les barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de carburant dont peuvent se servir certaines entreprises au titre de leurs déplacements professionnels.
Marion Beurel
Les exploitants individuels relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices agricoles (BA) ainsi que les sociétés civiles de moyens (SCM) qui sont soumis au régime simplifié d’imposition et qui tiennent une comptabilité dite « super-simplifiée » peuvent évaluer de façon forfaitaire les frais de carburant consommé lors de leurs déplacements professionnels en utilisant les barèmes publiés, chaque année, par l’administration fiscale.
Ces barèmes visent principalement les dépenses de carburant relatifs aux véhicules automobiles et aux deux-roues à usage mixte (personnel et professionnel). Les frais de carburant consommé par des véhicules affectés uniquement à un usage professionnel, comme les véhicules utilitaires ou les tracteurs, ne peuvent donc pas être évalués d’après ces barèmes. Rappelons que les barèmes fixent un tarif par kilomètre, variant selon le type de carburant (gazole, super sans plomb, G.P.L.) et la puissance fiscale du véhicule.
Les barèmes applicables aux frais engagés en 2025, qui serviront notamment à remplir la prochaine déclaration de résultats des exploitants, viennent d’être publiés. Des barèmes qui sont, une fois encore, en baisse par rapport à ceux de l’an dernier, qu’il s’agisse du gazole, du super sans plomb ou du G.P.L., et ce, tant pour les véhicules de tourisme que pour les véhicules deux-roues motorisés.
| Barème des frais de carburant « auto » 2025 (par km) | |||
| Puissance | Gazole | Super sans plomb | G.P.L. |
| 3 à 4 CV | 0,089 € | 0,113 € | 0,072 € |
| 5 à 7 CV | 0,110 € | 0,139 € | 0,089 € |
| 8 et 9 CV | 0,131 € | 0,165 € | 0,106 € |
| 10 et 11 CV | 0,148 € | 0,187 € | 0,120 € |
| 12 CV et plus | 0,165 € | 0,208 € | 0,133 € |
À noter : : l’exploitant doit être en mesure de justifier de l’utilisation professionnelle du véhicule et du kilométrage parcouru à ce titre.
À savoir : : ces barèmes peuvent également être utilisés, sous certaines conditions :- par les professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) pour leurs véhicules pris en location ou en crédit-bail en cas de déduction des loyers correspondants ;- par les salariés qui déduisent leurs frais professionnels réels et qui n’utilisent pas les barèmes kilométriques ;- par les associés de sociétés de personnes qui exercent leur activité professionnelle dans la société, au titre de leur trajet domicile-travail.

Crée le 26-02-2026
Stratégie nationale de cybersécurité 2026-2030
MultimédiaLe Guide du Chef d-EntrepriseTendancesMultiMédiaBoucle VidéoAssociationsActualitéÀ l’heure du tout numérique et de la montée en puissance des cybermenaces, le gouvernement vient de publier sa stratégie nationale de cybersécurité pour les années 2026 à 2030.
Isabelle Capet
Dans un « contexte marqué par la multiplication et l’imbrication des menaces telles que le terrorisme, la prolifération, les cyberattaques ou les modes d’action hybrides », chaque pays, et le nôtre en particulier, doit adapter et renforcer ses dispositifs de protection. Pour faire de la France un pôle majeur de la cybersécurité mondiale, le gouvernement vient ainsi de publier sa stratégie nationale de cybersécurité. 5 piliers ont été retenus pour mettre en place cette stratégie. Le premier prévoit de faire de la France le plus grand vivier de talents cyber d’Europe. L’objectif étant d’orienter la jeunesse vers ces métiers d’avenir et de renforcer toutes les voies de formation initiale, continue et de reconversion.
Le deuxième pilier propose de renforcer la résilience cyber de la Nation, le troisième d’entraver l’expansion de la cybermenace et le quatrième de garder la maîtrise de la sécurité de nos fondements numériques. Quant au cinquième et dernier pilier, il prévoit de soutenir la sécurité et la stabilité du cyberespace en Europe et à l’international. Toutes ces actions visent à élever le niveau global de cybersécurité, à préparer l’ensemble des acteurs aux crises et à faciliter l’accès à la cybersécurité par un accompagnement renforcé des victimes. La France entend donc mobiliser tous ses leviers – judiciaires, diplomatiques, militaires, économiques et techniques – pour entraver l’expansion de la cybermenace.
Pour en savoir plus :

Crée le 25-02-2026
La procédure d’injonction de payer s’accélère !
GestionJuridiqueGestion de l-entrepriseLe Guide du Chef d-EntrepriseContratsTrésorerie/Délais de paiementComptabilitéBoucle VidéoAssociationsActualitéPour plus de rapidité et d’efficacité, la procédure d’injonction de payer est modifiée. Des modifications qui s’appliqueront aux ordonnances d’injonction de payer rendues à compter du 1 septembre prochain.
Christophe Pitaud
Lorsque vous n’êtes pas parvenu à recouvrer à l’amiable (après relance, puis mise en demeure) une somme d’argent qui vous est due, par exemple par un client, vous pouvez recourir à la procédure d’injonction de payer. Rapide, simple et peu coûteuse, cette procédure judiciaire vous permet d’obtenir d’un juge une ordonnance qui enjoint votre débiteur de régler sa facture et qui vous autorise ensuite à faire procéder, si besoin, à la saisie de ses biens.
Pour qu’elle gagne en rapidité et en efficacité, cette procédure vient d’être modifiée.
Rappelons d’abord que pour engager une procédure d’injonction de payer, il vous suffit d’adresser une requête au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire, selon les cas, dans le ressort duquel votre débiteur est immatriculé ou réside. Si le juge estime que votre requête est fondée, il rendra, en principe quelques jours plus tard, une ordonnance enjoignant votre débiteur de payer sa dette. Vous devrez alors envoyer à ce dernier, par acte de commissaire de justice, une copie de cette ordonnance.
Premier changement apporté à la procédure : actuellement, l’ordonnance d’injonction de payer doit être notifiée (on parle de « signification » de l’ordonnance) au débiteur dans un délai de 6 mois. Ce délai est ramené à 3 mois. Ce qui est évidemment de nature à accélérer le processus. Mais attention, si l’ordonnance n’est pas signifiée dans ce (court) délai, elle devient caduque.
Après avoir reçu l’ordonnance d’injonction de payer, le débiteur peut décider de payer. Mais s’il n’est pas d’accord sur l’existence ou sur le montant de la créance, il peut aussi, dans le mois qui suit la réception de l’ordonnance, contester celle-ci en formant opposition devant le tribunal qui l’a rendue. Deuxième changement : désormais, sauf si la procédure se déroule devant le tribunal de commerce, le greffier du tribunal avisera le créancier de cette opposition dans un délai d’un mois à compter de sa réception ; ce qui n’est pas le cas actuellement, le créancier étant, en cas d’opposition formée par le débiteur, convoqué par le tribunal pour une tentative de conciliation dans un délai indéfini.
Cette information par le greffier permettra donc au créancier de basculer rapidement vers une procédure contentieuse devant le tribunal, ce qui, là encore, est de nature à éviter une perte de temps.
Actuellement, si le débiteur ne conteste pas l’ordonnance d’injonction de payer dans le délai d’un mois mais ne paie pas sa dette pour autant, le créancier est alors en droit de faire exécuter l’ordonnance et de faire procéder à une saisie de ses biens. Mais en pratique, le créancier attend souvent un retour du greffe avant de le faire.
Du coup, le troisième changement suivant est expressément prévu : si, à l’expiration d’un délai de 2 mois après la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, le créancier n’a reçu aucun avis d’opposition de la part du greffier, il peut faire exécuter l’ordonnance. Encore une mesure de simplification et d’efficacité qui va accélérer le recouvrement de la créance.
Précision : : ces modifications s’appliqueront aux ordonnances d’injonction de payer rendues à compter du 1 septembre 2026.

Crée le 24-02-2026
Un « droit à l’essai » pour l’exercice en commun d’une activité agricole
JuridiqueContratsLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableActualitéUn « droit à l’essai » a été récemment instauré pour permettre à une personne de tester un projet d’exercice en commun d’une activité agricole. Pour formaliser une telle association, une convention doit être conclue. Un modèle de convention-type est désormais disponible.
La Rédaction
On se souvient que la loi d’orientation agricole du 24 mars 2025 avait notamment pour objectif d’encourager le renouvellement des générations en agriculture et donc de favoriser l’installation de nouveaux exploitants.
Parmi les mesures prévues à cette fin, la loi a instauré un dispositif original de « droit à l’essai » afin de permettre à une personne qui souhaite tester un projet d’exercice en commun d’une activité agricole dans une exploitation ou dans une société avec un ou plusieurs autres exploitants. Formalisé par un contrat, cet essai a vocation à durer pendant un an, renouvelable une fois, avec une possibilité de résiliation à tout moment par les intéressés.
À ce titre, les pouvoirs publics viennent de mettre à disposition des intéressés un modèle de convention-type. Conclue à titre gratuit entre la personne à l’essai et l’exploitation qui l’accueille, cette convention doit préciser les conditions dans lesquelles l’essai d’association se réalise. Elle doit notamment indiquer la nature du lien contractuel entre les parties, à savoir soit un contrat de travail, soit un contrat d’apprentissage, soit un contrat de stage, soit un contrat d’entraide familiale, soit enfin un statut d’aide familial pour la personne à l’essai.
Elle doit également mentionner les modalités selon lesquelles la personne à l’essai est associée à la vie de l’exploitation (participation effective aux travaux, participation à la prise de décisions, accès aux documents comptables, financiers, techniques, contractuels…).
Ce modèle de convention figure en annexe d’un .

Crée le 24-02-2026
Période de reconversion : quelles formalités pour l’employeur ?
SocialLe Guide du Chef d-EntrepriseConditions de travailBoucle VidéoAssociationsActualitéL’employeur qui entend faire bénéficier un salarié d’une période de reconversion doit, dans les 30 jours qui précèdent le début de celle-ci, adresser une demande de prise en charge à son opérateur de compétences.
Coralie Carolus
Issu d’un accord national interprofessionnel, un nouveau dispositif baptisé « période de reconversion » est entré en vigueur en début d’année 2026. Un dispositif qui, pour favoriser la mobilité interne ou externe des salariés, leur permet d’acquérir une certification, un certificat de qualification professionnelle ou encore un ou plusieurs blocs de compétences. Et ce, au moyen, notamment, d’actions de formation et de l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles.
La période de reconversion d’un salarié peut se dérouler en interne, autrement dit dans l’entreprise où il travaille déjà, ou en externe, c’est-à-dire dans une entreprise d’accueil.
Dans les 30 jours calendaires qui précèdent le début de cette période, l’employeur (celui auprès duquel la période est réalisée) doit adresser, par voie dématérialisée, à l’opérateur de compétences (OPCO) dont il relève :- l’accord conclu avec le salarié pour mettre en place une période de reconversion interne ou externe, via le Cerfa n° 17613*01 ;- la convention conclue entre l’entreprise (où se déroule la période de reconversion) et l’organisme dispensant la formation au salarié ;- le cas échéant, le contrat de travail conclu entre le salarié et l’entreprise d’accueil.
À réception de ces documents, l’OPCO dispose de 20 jours calendaires pour se prononcer sur la prise en charge de la période de reconversion. Une prise en charge qui concerne les frais pédagogiques ainsi que, sous réserve qu’un accord collectif ou une décision unilatérale de l’employeur le prévoit pour les reconversions externes, les frais annexes (transport, hébergement, repas…) et la différence entre la rémunération actuellement perçue par le salarié et celle qu’il est amené à percevoir durant la période de reconversion. Sachant que le défaut de réponse de l’OPCO dans le délai imparti vaut rejet de la demande de prise en charge.
Précision : : la période de reconversion a remplacé les anciens dispositifs de promotion ou de reconversion par l’alternance (Pro-A) et de Transitions collectives (Transco).
Attention : : en cas de rupture anticipée de la période de reconversion, l’employeur doit en avertir son OPCO, par voie dématérialisée, dans les 30 jours qui suivent.

Crée le 23-02-2026
La loi de finances pour 2026 est publiée !
PatrimoineFiscalTaxes locales/Impôts locauxImpots sur le revenuFiscalitéFiscalité professionnelleFiscalité personnelleImpots sur les bénéficesLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableAssociationsActualitéLe Conseil constitutionnel a validé la quasi-totalité de la loi de finances pour 2026, y compris la nouvelle taxe sur les actifs non professionnels des holdings patrimoniales et le durcissement du pacte Dutreil. Zoom sur les principales mesures introduites.
Marion Beurel
Après plusieurs mois de débats, le projet de loi de finances pour 2026 a enfin été adopté après le rejet des deux dernières motions de censure déposées à la suite du recours à l’article 49.3. Et contre toute attente, le Conseil constitutionnel vient de valider la quasi-totalité de la loi de finances pour 2026, y compris la nouvelle taxe sur les actifs non professionnels des holdings patrimoniales et le durcissement du pacte Dutreil.
La loi a donc pu être promulguée et publiée dans la foulée. Tour d’horizon rapide des principales nouveautés concernant les particuliers et les entreprises.
Alors qu’il devait être gelé, le barème de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025, qui sera donc liquidé en 2026, est bel et bien revalorisé, à hauteur de 0,9 %, afin de prendre en compte l’inflation.
Par ailleurs, la contribution différentielle sur les hauts revenus, instaurée l’an dernier à titre temporaire, est finalement prorogée, et ce jusqu’à ce que le déficit public passe sous la barre des 3 %.
Et, point important, un nouveau dispositif d’incitation à l’investissement locatif voit le jour (« Relance logement »). Il permettra, dans certaines limites, de déduire de ses revenus fonciers un amortissement au titre des appartements, neufs ou réhabilités, acquis pour être loués nus, à titre de résidence principale, pendant au moins 9 ans, et d’imputer l’éventuel déficit foncier résultant de cette déduction sur son revenu global.
S’agissant des mesures intéressant les entreprises, l’anticipation de 2 ans de la suppression progressive de la CVAE est abandonnée. Le taux d’imposition maximal pour 2026 et 2027 reste donc gelé à 0,28 %, avant, en principe, d’être abaissé à 0,19 % en 2028 et à 0,09 % en 2029. La CVAE ayant vocation à être totalement supprimée en 2030.
Par ailleurs, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des très grandes entreprises (CA > 1,5 Md€ en 2026) est prolongée d’un an, sans réduction de moitié de ses taux, comme initialement prévu.
Enfin, la loi de finances prévoit plusieurs dispositifs de soutien pour les exploitants agricoles, notamment la reconduction de la déduction pour épargne de précaution (DPE) et l’élargissement de l’exonération partielle de la réintégration des sommes déduites, une nouvelle exonération fiscale au titre de l’indemnité perçue en cas d’abattage sanitaire d’animaux et affectée à la reconstitution d’un troupeau, la création d’un crédit d’impôt pour les dépenses de mécanisation collective en faveur des adhérents à une coopérative d’utilisation de matériel agricole (Cuma) et la prorogation des crédits d’impôt agriculture biologique et haute valeur environnementale (HVE).
Attention : : le Conseil constitutionnel ayant seulement validé la procédure d’adoption de ces dispositifs, leur conformité à la Constitution pourrait être remise en cause ultérieurement à l’occasion de questions prioritaires de constitutionnalité (QPC).
Précision : : parmi les autres mesures abandonnées, figure également l’abaissement des limites d’application de la franchise TVA. Elles restent donc fixées à 85 000 € pour le commerce, la restauration ou l’hébergement et à 37 500 € pour les autres activités.
À noter : : nous présenterons ultérieurement en détail chacune de ces mesures dans des articles dédiés.
Loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20
Décision du Conseil constitutionnel n° 2026-901 DC du 19 février 2026, JO du 20

Crée le 20-02-2026
Taxe d’apprentissage : du nouveau pour les associations
SocialLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableAssociationsActualitéLa loi de finances pour 2026 étend le champ d’application de la taxe d’apprentissage aux associations bénéficiant de la franchise pour leurs activités lucratives accessoires.
Sandrine Thomas
Les employeurs sont, en principe, redevables d’une taxe d’apprentissage calculée sur la rémunération de leurs salariés et dont le taux s’élève à 0,68 % (0,44 % en Alsace-Moselle).
Toutefois, jusqu’alors, seules les associations, fondations et fonds de dotations exerçant une activité lucrative et passibles de l’impôt sur les sociétés devaient payer la taxe d’apprentissage.
Mais la loi de finances pour 2026 a étendu son champ d’application. Aussi, sont désormais redevables de la taxe d’apprentissage :- les associations, les fondations reconnues d’utilité publique, les fondations d’entreprise et les fonds de dotation bénéficiant, pour leurs activités lucratives accessoires, de la franchise des impôts commerciaux ;- les associations sans but lucratif organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l’objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région ;- les organismes agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée, réalisant des opérations exonérées de TVA (services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres, manifestations de soutien ou de bienfaisance…) ;- les fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche.
À noter : : sous réserve de confirmation par les pouvoirs publics, cette mesure devrait entrer en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la loi de finances pour 2026, soit le 21 février.

Crée le 20-02-2026
Licenciement d’un salarié en arrêt de travail pour maladie professionnelle
SocialAutresRupture de contratLe Guide du Chef d-EntrepriseJurisprudenceBoucle VidéoAssociationsActualitéLe licenciement d’un salarié en arrêt de travail pour maladie professionnelle ne peut pas être justifié par les perturbations causées, par son absence prolongée, sur le fonctionnement de l’entreprise.
Sandrine Thomas
Un salarié en arrêt de travail peut être licencié si ses absences répétées ou prolongées perturbent le fonctionnement de l’entreprise ou d’un de ses services essentiels et que ces perturbations nécessitent son remplacement définitif via une embauche en contrat à durée indéterminée. Mais attention, un tel licenciement ne peut concerner qu’un salarié en arrêt de travail du fait d’un accident ou d’une maladie d’origine personnelle.
En effet, le salarié en arrêt de travail en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficie d’une protection contre le licenciement. Ce qui signifie qu’il ne peut être licencié que s’il commet une faute grave ou qu’il est impossible de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à son accident ou à sa maladie (cessation d’activité de son employeur, par exemple).
Dans une affaire récente, un employeur avait licencié un salarié placé en arrêt de travail depuis presque 9 mois en raison d’une maladie professionnelle. Un licenciement qu’il justifiait par les perturbations causées par l’absence prolongée du salarié sur le fonctionnement de l’entreprise lesquelles nécessitait son remplacement définitif. Le salarié avait contesté ce licenciement en justice.
La Cour de cassation a donné raison au salarié. En effet, elle a constaté que son licenciement prononcé pendant un arrêt de travail pour maladie professionnelle n’était justifié ni par une faute grave du salarié, ni par l’impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à sa maladie. Elle en a conclu que le licenciement du salarié était nul.

Crée le 20-02-2026
Le dirigeant caution doit être informé chaque année du montant des sommes garanties
GestionAutresJuridiqueTransversauxDéfaillance d-entrepriseContratsGaranties/SûretésLe Guide du Chef d-EntrepriseJurisprudenceFinancement d-entrepriseBoucle VidéoActualitéChaque année, la banque doit informer le dirigeant qui s’est porté caution pour sa société en garantie du solde d’un compte bancaire du montant des sommes garanties, et ce jusqu’à l’extinction de la dette, donc même après la clôture du compte.
Christophe Pitaud
Lorsqu’un dirigeant (personne physique) s’est porté caution pour sa société en contrepartie de l’octroi d’un crédit, le banquier est tenu de lui communiquer, chaque année avant le 31 mars, les informations suivantes :
- le montant de la somme garantie par le cautionnement et des intérêts, frais et accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente ;
- le terme de l’engagement de caution ou, s’il est à durée indéterminée, la faculté pour le dirigeant de le révoquer à tout moment, ainsi que les conditions d’exercice de cette révocation.
Et attention, si le banquier ne remplit pas cette obligation d’information, il perd le droit de réclamer au dirigeant caution les intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la communication de la nouvelle information.
À ce titre, les juges viennent de rappeler que cette information doit être délivrée par la banque au dirigeant caution jusqu’à l’extinction de la dette garantie par le cautionnement. Dans cette affaire, le dirigeant d’une société s’était porté caution notamment d’un crédit en compte courant ouvert au nom de la société à hauteur de 30 000 €. Lorsque cette dernière avait été placée en liquidation judiciaire, la banque avait appelé le dirigeant en paiement. Mais celui-ci avait alors demandé que la banque soit déchue du droit aux intérêts puisqu’elle n’avait pas rempli son obligation d’information à son égard chaque année.
Saisie du litige, la cour d’appel avait bien constaté des manquements de la banque à son obligation d’information annuelle, mais elle avait refusé de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts contractuels pour la période postérieure à la clôture du compte courant.
La Cour de cassation a censuré cette décision, affirmant que la clôture du compte courant n’avait pas mis fin à l’obligation de la banque d’informer chaque année le dirigeant caution, laquelle doit être respectée jusqu’à l’extinction de la dette.
À noter : : de même, dans l’hypothèse où il n’aurait pas informé le dirigeant de la défaillance du débiteur (c’est-à-dire la société) dès le premier incident de paiement non régularisé dans le délai d’un mois, le banquier ne pourrait pas lui réclamer le versement des intérêts de retard échus entre la date de cet incident de paiement et celle à laquelle le dirigeant en aurait finalement été informé. Et ce même si ce dernier est évidemment au courant de la situation de sa société.

Crée le 19-02-2026
Frais de repas déductibles : les seuils pour 2026
FiscalImpots sur les bénéficesLe Guide du Chef d-EntrepriseFiscalité professionnelleFiscalité des résultatsBoucle VidéoInstagramActualitéLes exploitants individuels (BIC ou BNC) peuvent, sous certaines conditions, déduire de leur résultat imposable les frais supplémentaires de repas pris sur leur lieu d’exercice de l’activité, dans la limite maximale de 15,90 € en 2026.
Marion Beurel
Les exploitants individuels relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC) selon un régime réel, qui sont contraints de prendre leur repas sur le lieu d’exercice de leur activité en raison de la distance qui sépare celui-ci de leur domicile, peuvent déduire de leur résultat imposable les frais supplémentaires de repas qu’ils engagent.
Ces frais correspondent à la fraction de la dépense qui excède le montant d’un repas pris à domicile, montant évalué forfaitairement par l’administration fiscale à 5,50 € TTC pour 2026.
Mais attention, la dépense engagée ne doit pas être excessive. Selon l’administration, elle ne doit pas dépasser, selon l’administration, pour 2026, 21,40 € TTC. En conséquence, le montant déduit par repas ne peut pas excéder 15,90 € TTC (soit 21,40 € - 5,50 €).
La fraction qui excède ce montant peut néanmoins être admise en déduction si l’exploitant justifie de circonstances exceptionnelles, notamment en l’absence de possibilités de restauration à moindre coût à proximité de son lieu d’activité.
À savoir : : l’exploitant doit être en mesure de produire toutes les pièces justificatives permettant d’attester de la nature et du montant de ces frais supplémentaires de repas. En outre, l’éloignement entre le lieu d’exercice de l’activité et le domicile doit être considéré comme normal par l’administration au regard de divers critères (configuration des agglomérations, nature de l’activité de l’entreprise, lieux d’implantation de la clientèle…) afin de ne pas résulter de la seule volonté de l’exploitant.

Crée le 18-02-2026
SCPI : 2025, l’année du rebond
PatrimoineImmobilierPlacementLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoInstagramActualitéLes sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI) affichent un rendement moyen de 4,91 % en 2025, soit une progression de 0,19 point par rapport à 2024.
Fabrice Gomez
Selon les dernières statistiques publiées par l’ASPIM et l’IEIF, le marché des sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI) se porte mieux. En effet, après deux années d’ajustement, l’exercice 2025 confirme une amélioration pour une partie des fonds immobiliers grand public.
En 2025, les SCPI ont collecté (collecte nette) 4,6 milliards d’euros, soit une hausse de 29 % par rapport à 2024. Une collecte qui se rapproche des niveaux observés avant la phase de correction.
Dans le détail, ce sont les SCPI diversifiées qui ont capté 65 % de la collecte brute de l’année 2025. Viennent ensuite les SCPI à prépondérance de bureaux (24 %), santé et éducation (4 %), logistique et locaux d’activité (3 %), commerces (2 %) et résidentiel (1 %). À noter que les SCPI à prépondérance « hôtel, tourisme, loisirs » ont capté moins de 1 % du total des souscriptions de 2025.
Du point de vue des performances, les SCPI, toutes catégories confondues, ont servi un rendement moyen de 4,91 % en 2025 (contre 4,72 % en 2024). Par catégories de SCPI, le taux de distribution moyen s’est établi, en 2025, à 4,2 % pour les SCPI résidentielles et santé et éducation, à 4,6 % pour les SCPI de bureaux, à 4,9 % pour les SCPI commerces, à 5,1 % pour les SCPI hôtels, tourisme et loisirs, à 5,6 % pour les SCPI logistique et locaux d’activité et à 6 % pour les SCPI diversifiées.
Autre information : en 2025, 50 % des SCPI du marché, en nombre, ont maintenu ou augmenté leurs acomptes par part (dividendes annuels versés sous forme d’acomptes) par rapport à 2024. Parmi elles, 36 % enregistrent une hausse moyenne pondérée (par la capitalisation) de 3 %. À l’inverse, 50 % des SCPI ont réduit leur dividende, avec une baisse moyenne pondérée de 10 %.
En 2025, 14 SCPI à capital variable ont diminué leur prix de souscription, tandis que 17 SCPI l’ont augmenté. Si l’essentiel des baisses est intervenu au premier trimestre 2025, le quatrième trimestre 2025 s’est distingué par 11 revalorisations de prix de part. Sur l’ensemble de l’année 2025, le prix de part moyen pondéré par la capitalisation a reculé de 3,45 %.
Précision : : les SCPI permettent à des particuliers d’investir dans l’immobilier sans détenir directement un appartement, un local commercial, une maison. L’investissement porte sur l’acquisition de parts de capital de ces sociétés qui détiennent elles-mêmes un patrimoine immobilier et redistribuent aux différents investisseurs, sous forme de dividendes, les loyers qu’elles perçoivent.
Précision : : au 31 décembre 2025, la capitalisation des SCPI s’établit à 89 milliards d’euros, en hausse de 1,3 % sur un trimestre et de 0,6 % sur un an.

Crée le 19-02-2026
Des DSN de substitution émises à compter de juin 2026
SocialLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoAssociationsActualitéL’Urssaf et la Mutualité sociale agricole pourront bientôt, en cas d’anomalies constatées dans les déclarations sociales nominatives des employeurs, les remplacer par des déclarations sociales nominatives de substitution.
Sandrine Thomas
Tout au long de l’année, les organismes qui recouvrent les cotisations sociales dues sur les rémunérations des salariés (Urssaf, Mutualité sociale agricole, Cnav, Agirc-Arrco…) peuvent signaler aux employeurs les anomalies constatées dans leurs déclarations sociales nominatives (DSN) mensuelles via un « compte-rendu métier » (CRM).
Il appartient alors à l’employeur qui reçoit un CRM de corriger l’anomalie ou de la contester de façon motivée. En cas de contestation, l’Urssaf et la Mutualité sociale agricole (MSA) peuvent revoir leur décision ou confirmer l’anomalie. Dans cette dernière hypothèse, elles répondent, de façon motivée, aux observations de l’employeur et mettent en recouvrement les cotisations et contributions restant éventuellement dues par ce dernier, ainsi que les pénalités et majorations de retard correspondantes.
Pour la première fois cette année, l’Urssaf et la MSA vont pouvoir émettre des DSN de substitution, c’est-à-dire des DSN remplaçant celles effectuées par l’employeur.
Dans le cadre de cette procédure, les organismes qui constatent, en 2026, que des anomalies n’ont pas été corrigées sur les DSN de 2025, transmettent d’abord à l’employeur un CRM de rappel annuel.
L’employeur qui recevra un CRM de rappel pourra, au plus tard dans la DSN d’avril 2026 transmise le 5 ou le 15 mai (selon l’effectif de l’entreprise), soit contester, soit corriger les anomalies listées dans le CRM de rappel. Si l’employeur ne conteste pas, n’apporte pas de corrections ou voit sa contestation rejetée, l’Urssaf ou la MSA procèdera elle-même, en juin 2026, à la correction des anomalies via des DSN de substitution.
L’employeur sera alors informé de ces corrections, ainsi que, le cas échéant :- de la mise en recouvrement des cotisations et contributions restant dues, ainsi que des pénalités et majorations de retard correspondantes ;- ou du montant du remboursement (ou de l’imputation sur ses prochains paiements) qui lui est dû s’il a versé des sommes en trop.
En pratique : : le CRM de rappel sera adressé le 13 mars pour les entreprises déclarant le 5 du mois et le 23 mars pour celles déclarant le 15 du mois.
Précision : : pour le moment, la DSN de substitution concerne uniquement les anomalies relatives à l’assiette brute plafonnée soumise aux cotisations d’assurance retraite (de base et complémentaire) des salariés (à l’exclusion notamment des apprentis, des salariés multi-employeurs et des mandataires sociaux).

Crée le 17-02-2026
Dans les coulisses d’un contrôle de la CNIL
MultimédiaMultiMédiaTendancesLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoAssociationsActualitéDans la série « Les Webinaires de la Cnil », qui décryptent un sujet ou une actualité en lien avec la protection des données, le dernier épisode disponible en replay est consacré aux coulisses d’une entreprise qui va faire l’objet d’un contrôle.
Isabelle Capet
Ce sont près de 120 agents de la CNIL qui sont habilités à mener un contrôle en entreprise, avec un large pouvoir d’investigation, mais astreints au secret. Quels sont les différents types de contrôle ? Comment se déroule un contrôle sur place ? Quels sont les droits et obligations des organismes contrôlés ? Quelles sont les suites d’un contrôle ? Dans l’un de ses webinaires, la CNIL répond à toutes les questions que se pose l’entreprise qui pourrait faire l’objet du contrôle.
Différentes modalités de contrôle peuvent, en effet, être combinées, qu’il s’agisse d’une vérification sur place, en ligne, sur pièces ou sur audition. L’objectif étant de recueillir tout renseignement ou toute justification utiles concernant la mise en œuvre de la loi et du réglement RGPD. Les agents sont habilités à se faire communiquer tout document nécessaire et à accéder aux programmes informatiques ainsi qu’aux données. Ces contrôles se déroulent le plus souvent de manière inopinée sur une journée, mais en fonction de la complexité du dossier, cela peut varier.
Pour en savoir plus :

Crée le 18-02-2026
Des sanctions plus sévères en cas de non-respect de la facturation électronique
FiscalTVAFiscalité professionnelleLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableAssociationsActualitéLa loi de finances pour 2026 alourdit les sanctions applicables aux entreprises qui ne respecteront pas leurs obligations dans le cadre de la réforme de la facturation électronique en vigueur à compter du 1 septembre prochain.
Marion Beurel
Comme vous le savez déjà, le recours à la facturation électronique entre entreprises assujetties à la TVA (« e-invoicing ») et la transmission à l’administration fiscale, par voie électronique, de données de transaction et de paiement exclues de la facturation électronique (« e-reporting ») vont devenir obligatoires à compter du 1 septembre 2026.
À compter du 1 septembre 2026, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, devront être en mesure de recevoir les factures électroniques. En outre, les grandes entreprises, les membres d’un groupe TVA et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) devront émettre des factures électroniques et effectuer l’e-reporting.
Ensuite, à compter du 1 septembre 2027, cette obligation d’émission de factures électroniques et d’e-reporting concernera également les TPE-PME et les micro-entreprises.
La loi de finances pour 2026 porte le montant de l’amende pour non-respect par une entreprise de l’obligation d’émission d’une facture électronique de 15 à 50 € par facture, sans modifier le plafond total des amendes fixé à 15 000 € par an.
De même, les amendes en cas de non-respect par une entreprise des obligations de fourniture des données de transaction ou de paiement seront relevées de 250 à 500 € par défaut de transmission, sans, là aussi, modifier le plafond total des amendes, au titre de chaque obligation (transaction ou paiement), fixé à 15 000 € par an.
Par ailleurs, une nouvelle sanction est instaurée à l’égard des entreprises qui ne respecteront pas leur obligation de recourir à une plate-forme agréée (PA) pour la réception de leurs factures électroniques. En effet, pour rappel, chaque entreprise concernée par la réforme devra avoir choisi une PA au 1 septembre 2026. Ainsi, lorsque l’administration constatera cette infraction, elle laissera 3 mois à l’entreprise pour se mettre en conformité. Passé ce délai, une amende 500 € s’appliquera. Un nouveau délai de 3 mois sera alors octroyé à l’entreprise afin de désigner une PA. Dans le cas où elle persisterait à méconnaître son obligation, une amende de 1 000 € lui sera infligée. Ensuite, une nouvelle amende de 1 000 € sera encourue, tous les 3 mois, tant que l’infraction perdurera.
Attention : : la loi de finances pour 2026 a été définitivement adoptée mais elle reste encore suspendue à la décision du Conseil constitutionnel qui pourrait invalider certaines de ses mesures.

Crée le 18-02-2026
Un soutien de l’Urssaf pour les entreprises victimes de la tempête Nils
SocialLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoAssociationsActualitéL’Urssaf met en place des mesures d’urgence, dont des délais de paiement de leurs cotisations sociales, à destination des entreprises sinistrées après le passage de la tempête Nils notamment en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine et dans les Pays de Loire.
Sandrine Thomas
Les employeurs et les travailleurs indépendants dont l’activité a été affectée par la tempête Nils notamment en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine et dans les Pays de Loire peuvent bénéficier d’un soutien de l’Urssaf.
Les employeurs peuvent demander à l’Urssaf un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales. Et ce, sans pénalités ni majorations de retard. En outre, l’Urssaf précise qu’elle sera compréhensive à l’égard des employeurs se trouvant dans l’impossibilité temporaire de réaliser leurs déclarations.
Les employeurs peuvent contacter l’Urssaf :- via leur messagerie sécurisée sur : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;- par téléphone au 3957.
Les travailleurs indépendants peuvent, eux aussi, demander à l’Urssaf un report du paiement de leurs échéances de cotisations sociales personnelles :- via leur messagerie sécurisée sur : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;- par téléphone au 3698.
Ils peuvent également demander au (CPSTI) une aide d’urgence pouvant aller jusqu’à 2 000 €. Cette aide, versée dans les 15 jours de la demande, vise à répondre aux besoins les plus urgents des travailleurs indépendants qui sont confrontés à des dégradations de leurs locaux professionnels, de leurs outils de production et/ou de leur résidence habituelle, si elle est le siège de leur entreprise ou en lien direct avec leur activité, et que ces dégradations impactent le fonctionnement de leur activité.
Les praticiens auxiliaires médicaux peuvent se voir octroyer un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales soit en suivant la même procédure que pour les employeurs ou les travailleurs indépendants, soit en composant le 0 806 804 209.
Ils peuvent aussi contacter leur caisse autonome de retraite pour bénéficier d’une aide d’action sociale : la Carmf pour les médecins, la CARCDSF pour les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes et la CARPIMKO pour les infirmiers libéraux, les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les orthoptistes et les pédicures-podologues.
À noter : : cette aide d’urgence est accessible aux professionnels libéraux relevant du CPSTI ou de la CIPAV.

Crée le 17-02-2026
Gare à la durée d’une convention pluriannuelle de pâturage !
AutresJuridiqueLe Guide du Chef d-EntrepriseJurisprudenceContratsBoucle VidéoImmanquableActualitéUne convention pluriannuelle de pâturage qui a été conclue pour une durée d’un an et qui s’est renouvelée au moins 4 fois ne répond pas à la condition d’être conclue pour une durée minimale de 5 ans.
Christophe Pitaud
Conclue entre un propriétaire et un éleveur dans une zone à vocation pastorale, la convention pluriannuelle de pâturage est un contrat portant sur des parcelles sur lesquelles ce dernier va faire paître ses animaux. Particularité de cette convention, elle est régie par une réglementation particulière et n’est donc pas soumise au statut du fermage. Mais attention, pour qu’il en soit ainsi, elle doit satisfaire aux conditions requises par la loi. À défaut, le statut du fermage retrouve à s’appliquer.
Parmi ces conditions figure une condition de durée. Ainsi, une convention pluriannuelle de pâturage doit être conclue pour une durée minimale de 5 ans.
À ce titre, dans une affaire récente, les juges ont requalifié une convention pluriannuelle de pâturage en bail rural soumis au statut du fermage au motif que cette convention avait été conclue, non pas pour une durée d’au moins 5 ans, mais pour une durée d’un an. Peu importe, selon les juges, qu’elle se soit renouvelée à au moins 4 reprises et qu’au total, elle se soit donc appliquée pendant plus de 5 ans.
Précision : : dans cette affaire, le bailleur avait agi en justice pour obtenir la résiliation de la convention pluriannuelle de pâturage pour défaut de paiement du loyer par le locataire. Pour faire échec à cette action, ce dernier avait alors sollicité la requalification de la convention en bail rural.

Crée le 17-02-2026
Instauration d’une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales
GestionJuridiqueTrésorerie/Délais de paiementLe Guide du Chef d-EntrepriseComptabilitéBoucle VidéoAssociationsActualitéUne proposition de loi, votée par le Sénat et soutenue par le gouvernement, prévoit d’instaurer une procédure simplifiée et déjudiciarisée de recouvrement des créances commerciales incontestées.
Christophe Pitaud
Une proposition de loi visant à permettre le recouvrement plus rapide des factures impayées et incontestées entre deux entreprises, sans avoir à agir en justice, mais en ayant recours à l’intervention d’un commissaire de justice puis d’un greffier de tribunal de commerce, a été votée par le Sénat fin janvier dernier avec le soutien du gouvernement. L’objectif étant de faciliter le quotidien des entreprises souvent fragilisées par les impayés de leurs clients.
Actuellement, pour recouvrer une créance impayée, le créancier doit agir en justice, souvent en ayant recours à la procédure d’injonction de payer. Mais bien que cette procédure soit simple et rapide, nombre d’entreprises, peu inclines à saisir la justice contre leurs clients, semblent hésiter à la mettre en œuvre, en particulier vis-à-vis de leurs clients importants. Et s’il existe déjà une procédure simplifiée de recouvrement des créances, elle est limitée aux dettes inférieures à 5 000 € et ne permet pas d’obtenir facilement un titre exécutoire lorsque le débiteur garde le silence. Sans compter les frais de procédure qui sont à la charge du créancier.
C’est la raison pour laquelle la création d’une procédure de recouvrement simplifiée élargie a été proposée par des sénateurs. Sans limite de montant, cette nouvelle procédure serait réservée aux créances commerciales, certaines, liquides et exigibles. Concrètement, l’entreprise victime d’une facture impayée pourrait demander à un commissaire de justice d’envoyer un commandement de payer à son débiteur. En l’absence de réaction de ce dernier, et 8 jours après l’expiration du délai d’un mois suivant l’envoi du commandement de payer, le commissaire de justice dresserait un procès-verbal de non-contestation. Puis ce procès-verbal serait rendu exécutoire par le greffier du tribunal de commerce après avoir vérifié la régularité de la procédure. Ainsi, en quelques semaines, l’entreprise créancière se verrait délivrer un titre exécutoire lui permettant de se faire payer.
Bien entendu, en cas de paiement de la facture par le débiteur ou de contestation par ce dernier de la créance ou du procès-verbal, il serait mis fin à la procédure.
Le texte doit maintenant être examiné par l’Assemblée nationale. À suivre…
Précision : : les frais occasionnés par la mise en œuvre de cette procédure seraient à la charge du seul débiteur.

Crée le 16-02-2026
Assurance loyers impayés : la garantie Visale évolue en 2026
PatrimoineLe Guide du Chef d-EntrepriseImmobilierBoucle VidéoActualitéDepuis le 6 janvier 2026, les plafonds de loyers et de ressources du dispositif Visale ont été relevés pour mieux s’adapter au marché locatif actuel.
Fabrice Gomez
Créée en 2016, la garantie Visale est un système de cautionnement gratuit, assuré par l’organisme Action Logement, qui couvre les loyers et les charges impayés de la résidence principale (location vide ou meublée) des locataires. Un dispositif qui permet au candidat à la location de renforcer son dossier et de rassurer le propriétaire qui bénéficie ainsi d’une garantie fiable. Ainsi, depuis sa création, plus de 1,7 million de contrats ont été mis en place. Récemment, les règles de ce dispositif ont évolué. Tour d’horizon des principales nouveautés.
Pour pouvoir bénéficier du dispositif Visale, le loyer (charges comprises) ne doit pas dépasser un plafond mensuel : 1 500 € en Île-de-France et 1 300 € sur le reste du territoire. À compter du 6 janvier 2026, les plafonds de loyers garantis par Visale sont relevés pour mieux tenir compte de l’évolution du marché locatif et refléter les particularités locales (cf. tableau ci-dessous). En outre, les montants de loyers garantis, différenciés selon la localisation des logements sur le territoire, tiennent désormais compte des spécificités des grandes agglomérations de plus de 100 000 habitants.
Pour faciliter l’accès au logement des salariés de plus de 30 ans, le plafond de ressources mensuel du locataire, jusqu’alors fixé à 1 500 € nets par mois, est porté à 1 710 €. Ce plafond de ressources revalorisé ouvre ainsi l’accès à la location privée à un plus grand nombre d’actifs dans un contexte de forte tension locative.
Jusqu’à présent, la garantie Visale pouvait couvrir jusqu’à 36 mois d’impayés de loyers et l’équivalent de 2 mois de loyers (charges comprises) en cas de dégradations locatives. Une garantie qui peut être déclenchée pendant toute la durée d’occupation du logement. Nouveauté : Visale couvre désormais, avec les mêmes garanties, les 3 premières années d’occupation seulement.
| Loyer maximal garanti par mois | ||||
| Plafond 2025 | Plafond 2026 | Plafond 2025 | Plafond 2026 | |
| Localisation du logement | Locataire déclarant des ressources | Forfait étudiant | ||
| Région Île-de-France | Jusqu’à 1 500 € | Jusqu’à 1 940 € | 800 € | 1 000 € |
| Agglomérations > 100 000 habitants, la Corse, les DROM et Saint Martin (COM) | Jusqu’à 1 300 € | Jusqu’à 1 575 € | 600 € | 840 € |
| Toutes les autres communes | Jusqu’à 1 365 € | 680 € | ||
Précision : : à l’issue de ces 3 ans, le dispositif prévoit la possibilité d’établir un nouveau cautionnement Visale, mais à condition que le locataire soit toujours éligible et qu’il effectue une nouvelle demande auprès de Visale.fr.
À noter : : le montant du loyer garanti est calculé en fonction des ressources du locataire, dans la limite de 50 % de ses revenus. Par exemple, si les revenus du locataire sont de 1 200 € nets par mois et le montant mensuel du loyer est fixé à 450 € (logement hors Île-de-France et hors agglomération de plus de 100 000 habitants), le loyer maximal garanti par Visale pour ce locataire est de 600 € (1 200 / 2) pour un plafond de 1 365 €.

Crée le 12-02-2026
Associations : taxe sur les salaires 2026
FiscalLe Guide du Chef d-EntrepriseFiscalité professionnelleBoucle VidéoImmanquableAssociationsActualitéLe barème de la taxe sur les salaires et l’abattement applicable aux associations sont revalorisés de 0,9 % en 2026.
Sandrine Thomas
Les limites des tranches du barème de la taxe sur les salaires sont relevées de 0,9 % au titre des rémunérations versées à compter du 1 janvier 2026.
Compte tenu de cette revalorisation annuelle, le barème 2026 de la taxe sur les salaires est le suivant :
Aucune taxe n’est due lorsque son montant est inférieur ou égal à 1 200 €. Si le montant de la taxe est supérieur à 1 200 € et inférieur à 2 040 €, il est appliqué une décote égale aux trois quarts de la différence entre 2 040 € et le montant de la taxe exigible.
| Taxe sur les salaires 2026 | ||
| Taux |
Tranches de salaire brut pour un salarié | |
| Salaire mensuel | Salaire annuel | |
| 4,25 % | ≤ 769 € | ≤ 9 229 € |
| 8,50 % | > 769 € et ≤ 1 535 € | > 9 229 € et ≤ 18 423 € |
| 13,60 % | > 1 535 € | > 18 423 € |
| (1) Taux de 2,95 % en Guadeloupe, Martinique et à La Réunion et de 2,55 % en Guyane et à Mayotte (toutes tranches confondues) | ||
À savoir : : l’abattement sur la taxe sur les salaires, dont bénéficient les organismes sans but lucratif, passe, quant à lui, de 24 041 € en 2025 à 24 256 € en 2026.

Crée le 13-02-2026
Régularisation en cours de contrôle fiscal et intérêt de retard réduit : comment procéder ?
FiscalFiscalité professionnelleFiscalité personnelleLe Guide du Chef d-EntrepriseContrôle fiscalBoucle VidéoAssociationsActualitéLe formulaire que les contribuables peuvent utiliser pour demander, au cours d’un contrôle fiscal, la régularisation d’erreurs commises dans leurs déclarations, et ainsi bénéficier d’un intérêt de retard à taux réduit, a été aménagé.
Marion Beurel
En principe, les contribuables, particuliers comme entreprises, peuvent, au cours d’un contrôle fiscal (contrôle sur pièces, vérification ou examen de comptabilité, examen de situation fiscale personnelle), régulariser les erreurs commises dans leurs déclarations, et ainsi bénéficier d’un intérêt de retard réduit de 30 %, soit un taux de 0,14 % par mois (au lieu de 0,20 %).
Pour cela, ils doivent faire une demande écrite, dans un délai variable selon le type de contrôle. À cette fin, ils peuvent utiliser l’imprimé n° 3964. Un formulaire qui vient d’être aménagé par l’administration fiscale et qui se décline désormais en trois versions, à savoir :- l’imprimé n° 3964-CFE-P pour un contrôle fiscal externe (vérification ou examen de comptabilité, ESFP) dont la demande de régularisation est remise en main propre ;- l’imprimé n° 3964-CFE-D pour un contrôle fiscal externe dont la procédure de régularisation est effectuée à distance ;- l’imprimé n° 3964-CSP pour un contrôle sur pièces, que la régularisation soit réalisée en présentiel ou à distance.
Pour bénéficier de l’intérêt de retard à taux réduit, les contribuables doivent également déposer une déclaration complémentaire de régularisation (DCR) dans les 30 jours de leur demande de régularisation. Jusqu’à présent, cette déclaration pouvait être réalisée à l’aide de l’imprimé n° 3949. Désormais, par mesure de simplification, elle peut également être effectuée sur l’imprimé n° 3964. Un imprimé unique est donc instauré pour la demande de régularisation et la DCR.
À noter : : cette régularisation ne peut porter que sur les impôts visés par le contrôle. Pour les autres impôts, une procédure de régularisation spontanée est possible, avec un taux d’intérêt de retard réduit de moitié (soit 0,10 % par mois).
Précision : : dans l’hypothèse d’une régularisation à distance, l’administration envoie le formulaire par voie électronique via une plate-forme d’échange sécurisée (Escale) ou par courrier. Le contribuable doit l’imprimer, le compléter, le signer et renvoyer une copie scannée par courriel ou via la plate-forme d’échange sécurisée ou, à défaut, par courrier postal.
En pratique : : dans le cadre d’un contrôle fiscal externe dont la procédure de régularisation est mise en œuvre en présentiel, la demande de régularisation et la DCR peuvent être signées simultanément lors d’un rendez-vous au moyen de l’imprimé n° 3964-CFE-P. Pour une régularisation à distance, l’administration fait parvenir la DCR (imprimé n° 3964-CFE-D ou n° 3964-CSP) au contribuable via la plate-forme d’échange sécurisée ou par courrier.

Crée le 12-02-2026
Décès du conjoint : le transfert de titres entre PEA n’est pas possible !
PatrimoineLe Guide du Chef d-EntreprisePlacementBoucle VidéoActualitéEn raison de la réglementation, le transfert des titres du PEA du défunt vers celui de son conjoint survivant n’est pas réalisable. Seul un transfert sur un compte-titres ordinaire au nom du conjoint est autorisé.
Fabrice Gomez
Le Plan d’épargne en actions (PEA) est un produit plébiscité pour investir sur les marchés financiers (on en dénombrait près de 7,2 millions à fin 2024). Mais c’est aussi un produit pour lequel il existe un contentieux important. Selon le rapport annuel d’activité du médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF), en 2024, le PEA et l’épargne salariale ont été les premiers motifs de saisine du médiateur, même si leur nombre est en baisse. Les délais de transfert d’un PEA en cas de changement d’établissement représentent les deux tiers des litiges et la détention de titres non cotés constitue également un facteur de complexité. Et récemment, le médiateur de l’Autorité des marchés financiers a été amené à se pencher sur un autre type de litige lié au PEA.
Dans cette affaire, à la suite d’un décès, l’établissement financier dans lequel le défunt détenait un PEA avait indiqué au conjoint survivant qu’il lui était possible de transférer vers son propre PEA les titres détenus par son époux décédé. Trois mois après cet échange, le service succession de l’établissement avait informé le conjoint que cette opération n’était finalement pas réalisable. Mécontente, l’épouse avait sollicité l’intervention du médiateur de l’AMF.
Le médiateur avait alors interrogé la banque. Cette dernière a indiqué qu’en raison de la réglementation applicable au PEA, les titres ne pouvaient être transférés que sur un compte-titres ordinaire ouvert au nom de l’épouse.
La seule manière permettant à l’épouse d’inscrire ces titres sur son propre PEA aurait consisté à procéder à leur cession, à verser le produit de la vente sur le compte-espèces de son plan, dans la limite du plafond des versements autorisés, puis à souscrire à nouveau les mêmes titres.
En résumé : l : e décès du titulaire d’un PEA entraîne sa clôture automatique et déclenche le calcul des éventuels prélèvements sociaux dus, lesquels sont directement déduits par le teneur de comptes. Les titres sont alors conservés dans un compte succession dans l’attente des instructions des héritiers. Ces derniers pouvant demander à l’établissement financier, par exemple, leur conservation sur un compte-titres ordinaire ou leur cession et bénéficier ainsi du produit de la vente.

Crée le 13-02-2026
Invalidation d’une cession d’actions : quand le cédant retrouve-t-il sa qualité d’associé ?
JuridiqueAutresJurisprudenceLe Guide du Chef d-EntrepriseSociétésDroits des sociétésBoucle VidéoActualitéLorsqu’une cession d’actions est invalidée par les juges, le cédant retrouve sa qualité d’associé à la date de l’assignation en justice, ce qui peut avoir une incidence sur la validité des assemblées générales qui sont tenues après cette date.
Christophe Pitaud
À quelle date l’invalidation par les juges d’une cession d’actions prend-elle effet ? La réponse à cette question vient d’être apportée par les juges dans l’affaire récente suivante.
Après avoir cédé ses actions, un actionnaire de société anonyme avait demandé en justice l’invalidation de l’opération car le solde du prix ne lui avait pas été payé. Les juges lui avaient donné gain de cause et ordonné à la société de modifier le registre des mouvements de titres et les comptes d’actionnaires.
Par la suite, cet actionnaire avait de nouveau agi en justice pour, cette fois, demander l’annulation des assemblées générales qui s’étaient tenues entre la date à laquelle il avait demandé la résiliation de la cession et celle du jugement, assemblées auxquelles il n’avait pas été convoqué. L’acquéreur des actions, ainsi que la société, avaient alors fait valoir que seuls les actionnaires peuvent demander l’annulation des assemblées générales et que l’intéressé n’avait pas cette qualité au moment de la tenue des assemblées générales considérées puisque ses actions n’étaient pas inscrites en son nom sur son compte d’actionnaires.
Mais les juges n’ont pas été sensibles à cet argument. En effet, ils ont rappelé que l’invalidation d’un contrat (en l’occurrence, une cession d’actions) par les juges (on parle de « résolution ») prend effet, sauf précision contraire du jugement, au jour de l’assignation en justice. Par conséquent, dans cette affaire, le cédant des actions avait retrouvé sa qualité et ses droits d’actionnaire à cette date. Peu importe, selon les juges, si, à cette date, la société ne l’avait pas encore réinscrit dans son compte individuel d’actionnaire ou dans ses registres de titres nominatifs. L’intéressé était donc en droit de demander l’annulation des assemblées générales litigieuses.

Crée le 10-02-2026
Le salarié qui concurrence son employeur est fautif !
AutresSocialRupture de contratLe Guide du Chef d-EntrepriseJurisprudenceBoucle VidéoAssociationsActualitéLe salarié qui, sous le statut d’auto-entrepreneur, exerce une activité concurrente à celle de son employeur peut être licencié pour faute grave.
Coralie Carolus
Du fait de leur contrat de travail, les salariés sont soumis à une obligation de loyauté à l’égard de leur employeur. Ils doivent ainsi faire preuve de bonne foi, de discrétion ou encore de confidentialité, mais aussi s’abstenir d’exercer une activité concurrente à leur employeur. Une décision récente de la Cour de cassation vient à nouveau illustrer ce principe.
Dans cette affaire, un salarié engagé en tant que menuisier avait créé une auto-entreprise dont l’activité consistait en des « travaux de menuiserie, bois et PVC ». Estimant que le salarié avait débuté et développé une activité concurrente à la sienne, son employeur l’avait licencié pour faute grave. Un licenciement que le salarié avait contesté en justice.
Saisis du litige, les juges d’appel avaient donné raison au salarié. Pour considérer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ils avaient retenu que l’activité d’auto-entrepreneur du salarié avait été exercée en dehors de son temps de travail et sans utiliser le matériel de son employeur. Ils avaient également relevé, notamment, que le salarié n’était soumis à aucune clause de non-concurrence et que son activité indépendante était demeurée résiduelle (2 581 € de chiffre d’affaires en 4 mois).
Mais pour la Cour de cassation, le seul fait pour le salarié de créer et d’exercer, sous le statut d’auto-entrepreneur, tout en étant au service de son employeur, une activité directement concurrente de l’une des siennes, est constitutif d’une faute rendant impossible son maintien dans l’entreprise. Peu importe les arguments retenus par les juges d’appel. Des juges qui sont alors « invités » à réexaminer cette affaire et à valider le licenciement pour faute grave du salarié.
À noter : : dans une précédente décision, la Cour de cassation a également validé le licenciement pour faute grave d’un salarié qui, pendant un arrêt de travail, avait « tenté » de proposer ses services, sous le statut de travailleur indépendant, à une société concurrente de son employeur. Les prestations proposées faisant partie des travaux réalisés par son employeur ().

Crée le 11-02-2026
L’aide à la création d’entreprise moins généreuse
CréationSocialTransversauxLe Guide du Chef d-EntrepriseCréation d-entrepriseBoucle VidéoActualitéDepuis le 1 janvier 2026, le montant de l’exonération de cotisations sociales accordée au titre de l’Acre ne peut dépasser le quart des cotisations dues pour les créateurs et repreneurs d’entreprise.
Sandrine Thomas
L’aide à la création ou à la reprise d’une entreprise (Acre) permet aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise de bénéficier d’une exonération de certaines cotisations sociales personnelles (cotisations d’assurance maladie-maternité, de vieillesse de base, d’invalidité-décès et d’allocations familiales) pendant les 12 premiers mois de leur activité.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a diminué le montant de cette exonération pour les créations ou reprises d’activité intervenues depuis le 1 janvier 2026.
Jusqu’alors, le créateur ou repreneur d’entreprise qui percevait un revenu annuel inférieur ou égal à 75 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass), soit à 36 045 € en 2026, bénéficiait d’une exonération totale de ses cotisations sociales personnelles. Depuis le 1 janvier 2026, le montant de cette exonération s’élève à 25 % du montant total des cotisations d’assurance maladie, maternité, veuvage, de vieillesse de base, d’invalidité-décès et d’allocations familiales dû par l’entrepreneur.
Comme auparavant, l’exonération de cotisations :- est dégressive pour un revenu supérieur à 75 % et inférieur à 100 % du Pass (48 060 € en 2026) ;- est nulle pour un revenu au moins égal au Pass.
En pratique : : l’Acre n’est plus automatiquement attribuée aux créateurs et repreneurs d’entreprise. Ces derniers doivent en faire la demande auprès de l’Urssaf dans les 60 jours qui suivent la date d’ouverture de l’activité mentionnée sur le justificatif de création d’activité délivré par le .
Attention : : cette nouvelle règle ne concerne pas les créateurs et repreneurs d’exploitation ou d’entreprise agricole.

Crée le 12-02-2026
État des lieux de la cybersécurité des entreprises françaises
MultimédiaTendancesMultiMédiaLe Guide du Chef d-EntrepriseAssociationsActualitéLe baromètre annuel du CESIN, effectué avec OpinionWay, vient de paraître. Réalisé auprès des Directeurs Cybersécurité et Responsables Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI), il dévoile les grandes tendances de la cybersécurité en entreprise.
Isabelle Capet
Quelle est la réalité concrète du risque cyber en entreprise ? C’est ce qu’analyse le baromètre annuel du CESIN, ce club réunissant des responsables de la cybersécurité venant d’entreprises de tous secteurs d’activités et d’administrations. Il ne prend en compte que les cyberattaques significatives, celles qui ont entraîné un impact réel sur l’activité, les données, la conformité réglementaire ou l’image de l’entreprise. Il indique qu’en 2025, 40 % des entreprises interrogées ont subi au moins une cyberattaque significative, un chiffre en baisse continue depuis plusieurs années.
Cette diminution des cyberattaques ne veut toutefois pas dire que la menace est en recul, mais plutôt que les entreprises s’améliorent dans leur détection, leur prévention et leur réaction. 81 % d’entre elles estiment d’ailleurs que l’attaque a eu un impact sur leur business (perturbations de production, pertes d’image, compromission ou vol de données...). Fait notable qui ressort du baromètre : dans un contexte géopolitique de plus en plus instable, plus d’une entreprise sur 2 se déclare concernée par les enjeux de souveraineté numérique et de cloud de confiance, une hausse significative par rapport à l’an dernier.
Pour consulter le baromètre :

Crée le 10-02-2026
Suspension de la réforme des retraites : Info-retraite.fr se met à jour
PatrimoineSocialFamilleLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoInstagramActualitéLa loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 suspend la réforme des retraites. Ce qui conduit notamment au maintien à 62 ans et 9 mois de l’âge légal de départ à la retraite. Ces nouveaux paramètres ont été intégrés récemment au simulateur « Mon estimation retraite ».
La Rédaction
Promulguée fin décembre 2025, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a temporairement suspendu la dernière réforme des retraites. Un retour en arrière qui a pu mettre les différentes caisses de retraite dans l’embarras et créé la confusion dans l’esprit des assurés, et plus particulièrement dans celui des personnes qui approchent de la fin de leur carrière professionnelle.
À ce titre, pour connaître leur nouvelle situation, les assurés peuvent faire appel au simulateur « Mon estimation retraite », accessible depuis le site info-retraite.fr. En effet, cet outil vient d’être actualisé et tient donc compte de certains changements opérés par la dernière loi de financement de la Sécurité sociale. Ainsi, le simulateur intègre notamment :- l’ajustement des âges et des trimestres pour les générations nées entre 1964 et 1968 ;- la prise en compte par la CNAC, la CNAV-TI, la MSA-SA et MSA-NSA et la CAVIMAC des 23 ou 24 meilleures années pour les mères de famille.
D’autres mises à jour, qui seront intégrées dans les prochains mois, sont d’ores et déjà planifiées. Elles concernent :- l’ajout de deux trimestres « enfant » pris en compte pour la carrière longue ;- la mise à jour de la surcote parentale ;- l’ajout d’un trimestre de bonification de durée de liquidation pour les femmes fonctionnaires ;- la publication du parcours simulation Cumul Emploi-Retraite lorsque les décrets d’application de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 seront publiés.
Dans le cadre de la dernière réforme des retraites (2023), l’âge légal de départ à la retraite est progressivement relevé de 62 à 64 ans. Il en est de même de la durée d’assurance requise pour obtenir une pension de retraite à taux plein (50 %) : celle-ci est progressivement relevée de 168 à 172 trimestres (soit 43 ans).
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 suspend le relèvement progressif de l’âge légal de départ à la retraite et de la durée d’assurance requise pour obtenir une pension de retraite à taux plein. En pratique, la loi maintient à 62 ans et 9 mois l’âge légal de départ à la retraite et à 170 trimestres la durée d’assurance requise pour obtenir une pension de retraite à taux plein pour les personnes nées entre le 1 janvier 1964 et le 31 mars 1965.
Voici les modifications apportées au calendrier de déploiement de la réforme des retraites de 2023 :
| Âge légal de départ à la retraite et durée d’assurance requise* | ||||
| Année de naissance | Règles issues de la réforme des retraites de 2023 | Règles issues de la LFSS 2026 | ||
| Âge légal de départ à la retraite | Durée d’assurance requise | Âge légal de départ à la retraite | Durée d’assurance requise | |
| 1963 | 62 ans et 9 mois | 170 | 62 ans et 9 mois | 170 |
| 1964 | 63 ans | 171 |
|
|
| 1965 (du 1 |
63 ans et 3 mois | 172 |
|
|
| 1965 (du 1 |
63 ans et 3 mois | 172 |
|
|
| 1966 | 63 ans et 6 mois | 172 |
|
172 |
| 1967 | 63 ans et 9 mois | 172 |
|
172 |
| 1968 | 64 ans | 172 |
|
172 |
| 1969 | 64 ans | 172 | 64 ans | 172 |
| *Nombre de trimestres de retraite nécessaires à l’obtention d’une pension de retraite à taux plein. | ||||
Exemple : : une personne née le 1 janvier 1964 peut bénéficier de sa pension à compter du 1 septembre 2026 (au lieu du 1 janvier 2027 auparavant).
Précision : : l’aménagement de la durée d’assurance requise bénéficie également aux assurés qui peuvent prétendre à un départ anticipé pour carrière longue, inaptitude ou invalidité.

Crée le 10-02-2026
Paiement des indemnités journalières aux non-salariés agricoles
SocialLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableActualitéLes conditions d’accès aux indemnités journalières pour les non-salariés agricoles placés en arrêt de travail sont assouplies depuis le 1 janvier 2026.
Sandrine Thomas
Les non-salariés agricoles (chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, collaborateurs d’exploitation, aides familiaux…) qui se trouvent dans l’incapacité physique temporaire d’exercer leur activité en raison d’une maladie ou d’un accident de la vie privée perçoivent des indemnités journalières de la Mutualité sociale agricole (MSA).
Pour cela néanmoins, ils doivent, en principe, être affiliés au régime d’assurance maladie, invalidité, maternité (Amexa) des non-salariés agricoles depuis au moins un an.
Par ailleurs, jusqu’au 31 décembre 2025, ils devaient également être à jour du paiement de leur cotisation Amexa au 1 janvier de l’année civile au cours de laquelle leur incapacité de travail était constatée par un médecin.
Afin de pas pénaliser les non-salariés agricoles qui seraient en retard sur le versement de leur cotisation Amexa, cette condition est assouplie pour les arrêts de travail prescrits depuis le 1 janvier 2026. Ainsi, pour bénéficier d’indemnités journalières, les non-salariés agricoles doivent, au 1 janvier de l’année civile au cours de laquelle leur incapacité de travail est médicalement constatée, être à jour de la cotisation Amexa due au titre de l’avant-dernière année civile.
Par ailleurs, en cas de retard de paiement de la cotisation Amexa, les non-salariés agricoles bénéficient des indemnités journalières à la date de règlement de celle-ci, à condition d’avoir acquitté la totalité de la cotisation restant due au titre de l’année civile précédant celle au cours de laquelle l’incapacité de travail est médicalement constatée.
Exemple : : pour un arrêt de travail prescrit en 2025, l’exploitant agricole devait être à jour, au 1 janvier 2025, de la cotisation Amexa due au titre de l’année 2024.
Exemple : : l’exploitant agricole dont l’incapacité de travail est constatée en 2026 doit, pour percevoir des indemnités journalières, avoir payé sa cotisation Amexa due au titre de 2024.
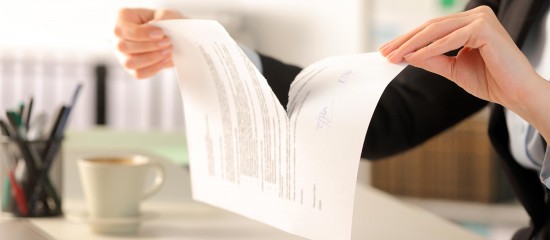
Crée le 10-02-2026
Contrat conclu hors établissement : gare aux informations données par le vendeur !
JuridiqueAutresCommerce/ConsommationContratsLe Guide du Chef d-EntrepriseJurisprudenceDroit des particuliersBoucle VidéoActualitéUn contrat conclu hors établissement avec un consommateur doit indiquer les caractéristiques essentielles du bien vendu, notamment sa marque. Lorsque la mention de cette dernière n’est pas suffisamment précise, le contrat peut être annulé.
Christophe Pitaud
Lorsqu’un bien est vendu à distance (en ligne ou par échange de courriels) ou hors établissement du vendeur (par exemple à domicile), ce dernier doit fournir au consommateur un exemplaire du contrat contenant, de manière lisible et compréhensible, un certain nombre d’informations, notamment les caractéristiques essentielles de ce bien. À défaut, le contrat de vente est susceptible d’être annulé.
À ce titre, les juges viennent de réaffirmer que la marque du produit vendu constitue une caractéristique essentielle du produit. Et donc que le contrat conclu hors établissement qui ne mentionne pas de façon suffisamment précise la marque du produit est nul.
Dans cette affaire, un particulier, qui avait conclu hors établissement du professionnel un contrat portant sur la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques, en avait demandé l’annulation au motif que le bon de commande mentionnait des panneaux d’une certaine marque « ou équivalent ». Il a obtenu gain de cause, les juges ayant estimé que cette mention (« ou équivalent ») n’était pas suffisamment précise.

Crée le 09-02-2026
Du nouveau pour les régimes simplifiés BIC et TVA
FiscalLe Guide du Chef d-EntrepriseTVAFiscalité professionnelleImpots sur les bénéficesBoucle VidéoImmanquableActualitéLes limites d’application des régimes simplifiés en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) font l’objet d’une revalorisation pour 2026.
Marion Beurel
Plusieurs régimes fiscaux simplifiés, donc moins contraignants, s’appliquent aux petites entreprises dès lors qu’elles respectent certains plafonds de chiffre d’affaires. À ce titre, les limites d’application des régimes simplifiés en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont actualisées pour 2026.
Ainsi, en 2026, le régime simplifié BIC s’applique aux entreprises industrielles ou commerciales exclues du régime micro-BIC et dont le CA HT de 2025 n’excède pas :- 945 000 € (au lieu de 840 000 € auparavant) pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ;- 286 000 € (au lieu de 254 000 € auparavant) pour les autres activités.
Lorsque ces limites sont franchies, le régime simplifié est maintenu la première année qui suit celle du dépassement, sauf en cas de changement d’activité.
En 2026, le régime simplifié de TVA s’applique, sauf exclusions, aux entreprises ne bénéficiant pas de la franchise TVA et dont le CA HT de 2025 n’excède pas :- 945 000 € pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ;- 286 000 € pour les autres activités.
Lorsque ces limites sont franchies, le régime simplifié peut être maintenu pour l’exercice en cours dès lors que le CA HT réalisé depuis le début de l’année n’excède pas, respectivement, 1 040 000 € et 323 000 €.
Si ces limites majorées sont dépassées, l’entreprise relève du régime normal à compter du 1 jour de l’année en cours. Elle doit alors déposer, le mois suivant celui du dépassement, une déclaration CA3 récapitulant les opérations réalisées depuis le début de cet exercice jusqu’au mois de dépassement, puis à compter du mois suivant, des déclarations mensuelles CA3.
Le régime simplifié TVA sera supprimé à compter du 1 janvier 2027. Les entreprises relevant jusqu’alors du régime simplifié seront donc soumises au régime normal de TVA et devront déposer des déclarations mensuelles ou trimestrielles. Sachant que, sauf option contraire, le régime déclaratif trimestriel s’appliquera automatiquement aux entreprises dont les chiffres d’affaires des années N-1 et N n’excèderont pas, respectivement, 1 M€ et 1,1 M€.
À savoir : : ces deux régimes d’imposition sont déconnectés l’un de l’autre. Ainsi, les entreprises soumises au régime simplifié BIC peuvent opter, si elles y ont intérêt, pour le régime normal. Une option qui n’entraîne pas l’application du régime normal en matière de TVA. Et inversement.
Rappel : : le régime simplifié BIC s’applique également, sur option, aux entreprises relevant normalement du régime micro-BIC.
Attention : : au 1 janvier 2027, les limites d’application du régime simplifié BIC seront, une nouvelle fois, réévaluées.
Rappel : : le régime simplifié TVA s’applique également, sur option, aux entreprises relevant normalement de la franchise TVA.
Précision : : pour bénéficier du régime simplifié ou de son maintien, le montant de la TVA exigible au titre de 2025 ne doit pas excéder 15 000 €.

Crée le 05-02-2026
En quoi consiste l’action de groupe ?
JuridiqueLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableAssociationsActualitéLes associations agréées peuvent déclencher des actions de groupe afin de défendre les intérêts individuels de plusieurs victimes d’un même manquement.
Sandrine Thomas
L’action de groupe est une action en justice portée par une association pour le compte de plusieurs victimes d’un même manquement.
L’action de groupe consiste, pour une association, à réunir les actions en justice individuelles de plusieurs victimes (personnes physiques ou morales) placées dans une situation similaire résultant d’un même manquement ou d’un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une même personne (entreprise, personne morale de droit public ou organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public).
Elle peut être exercée pour obtenir la cessation d’un manquement et/ou la réparation par des dommages-intérêts des préjudices (physiques, matériels…) subis du fait de ce manquement.
Pour déclencher une telle action, les associations doivent être agréées. Elles doivent donc déposer une demande d’agrément auprès du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF). Un arrêté doit encore préciser la composition du dossier de demande d’agrément et les modalités de saisine du DGCCRF. Ce dernier doit donner sa réponse dans les 3 mois suivant la délivrance de l’accusé de réception du dossier, sachant que l’absence de réponse vaut rejet de la demande. L’agrément est accordé pour 5 ans renouvelables.
Par exception, l’action de groupe qui tend à la seule cessation d’un manquement peut être formée par une association déclarée depuis au moins 2 ans, même si elle n’est pas agréée. Toutefois, pour cela, l’association doit justifier de l’exercice d’une activité effective et publique pendant 24 mois consécutifs et son objet statutaire doit comporter la défense des intérêts visés par l’action de groupe.
Enfin, les associations doivent informer le public des actions de groupe qu’elles intentent, de l’état d’avancement des procédures et du jugement rendu.
Exemples : : l’action de groupe peut avoir pour objet la réparation des effets secondaires d’un même médicament, la suppression de clauses abusives dans un contrat d’abonnement de téléphonie ou encore la cessation et/ou la réparation des discriminations à l’embauche commises par un même employeur.
À noter : : la liste des associations agréées sera publiée sur le site du ministère chargé de la Consommation.

Crée le 06-02-2026
Cautionnement disproportionné : la fiche de renseignements fait foi !
JuridiqueGestionAutresGaranties/SûretésFinancement d-entrepriseLe Guide du Chef d-EntrepriseJurisprudenceContratsBoucle VidéoActualitéLorsqu’il s’est porté caution pour sa société auprès d’une banque, le dirigeant qui a rempli une fiche de renseignements sur ses revenus, son patrimoine et ses charges, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut pas ensuite soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’il a déclarée.
Christophe Pitaud
Lorsqu’un cautionnement souscrit par une personne physique (par exemple, un dirigeant pour garantir un prêt contracté par sa société auprès d’une banque) était, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné par rapport à ses biens et à ses revenus, le créancier professionnel (la banque) ne peut pas s’en prévaloir en totalité. En effet, ce cautionnement est alors réduit au montant à hauteur duquel la caution (le dirigeant) pouvait s’engager à la date à laquelle il a été souscrit.
Sachant que si le cautionnement a été souscrit avant le 1 janvier 2022, la caution est même totalement déchargée de son obligation à l’égard de la banque.
À ce titre, pour démontrer que le cautionnement souscrit par un dirigeant en contrepartie d’un prêt pour sa société n’était manifestement pas disproportionné à ses revenus et à son patrimoine, la banque peut se prévaloir de la fiche de renseignements qu’il avait remplie.
C’est ce que les juges ont considéré dans l’affaire suivante. Le dirigeant d’une société s’était portée caution pour elle auprès d’une banque en contrepartie de l’octroi d’un prêt. À la demande de cette dernière, il avait rempli une fiche de renseignements faisant état de ses revenus, de son patrimoine et de ses emprunts. Mais lorsqu’il avait été sollicité par la banque à la suite de la défaillance de la société, il avait fait valoir que son cautionnement était disproportionné à ses biens et revenus en raison de cautionnements qu’il avait antérieurement souscrits, mais qu’il n’avait pas déclarés dans la fiche de renseignements.
Mais les juges n’ont pas été sensibles à cet argument. En effet, pour eux, la caution, en l’occurrence le dirigeant de la société, qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut pas ensuite soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier (la banque, donc). Pour démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le dirigeant n’était donc pas fondé à se prévaloir d’engagements de caution souscrits antérieurement, en invoquant le fait qu’il n’avait pas été invité à préciser leur existence dans la fiche de renseignements établie par la banque.
À noter : : dans cette affaire, les juges ont relevé que la banque pouvait valablement se fier à la fiche de renseignements remplie par l’intéressé, laquelle ne comportait pas d’anomalies apparentes, et ce d’autant plus que les engagements de caution dont il faisait état avaient été souscrits auprès d’autres établissements financiers que celle-ci, engagements dont elle n’avait pas eu connaissance.

Crée le 03-02-2026
Congés payés : des précisions apportées par les juges
SocialAutresConditions de travailLe Guide du Chef d-EntrepriseJurisprudenceBoucle VidéoAssociationsActualitéLe plafond annuel de 24 jours ouvrables de congés payés que le salarié peut réclamer au titre de ses arrêts de travail ne tient pas compte des jours de congé acquis sur les périodes de référence antérieures et reportés.
Coralie Carolus
Conformément à une loi publiée en avril 2024, les salariés cumulent des jours de congés payés durant leurs arrêts de travail. Ainsi, en cas d’arrêt consécutif à un accident ou une maladie d’origine non professionnelle, ils acquièrent 2 jours ouvrables de congés par mois (soit 24 jours ouvrables ou 20 jours ouvrés pour une absence d’un an).
Mais attention, car les pouvoirs publics ont donné à cette règle un effet rétroactif. Concrètement, les salariés sont en droit de réclamer à leur employeur les congés payés dont ils n’ont pas bénéficié au titre de leurs arrêts de travail intervenus depuis le 1 décembre 2009. Mais dans ce cadre, ils ne peuvent pas, en cas d’arrêt de travail consécutif à un accident ou une maladie d’origine non professionnelle, obtenir plus de 24 jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés) de congés payés par an, en prenant en compte les jours de congés qu’ils ont déjà acquis au titre des périodes de travail effectif ou assimilées comme telles (congé de maternité, de paternité, de formation…). Une règle qui vient d’être précisée par la Cour de cassation.
Dans une affaire récente, une salariée engagée en tant que gestionnaire de clientèle avait, après son départ de l’entreprise, réclamé en justice des rappels d’indemnités de congés payés au titre de l’année 2023. Elle estimait n’avoir pas bénéficié (ni sous forme de jours de repos, ni sous forme d’indemnité) de plusieurs jours de congés payés acquis durant trois arrêts de travail d’origine non professionnelle.
Dans ce litige, son employeur alléguait qu’il fallait déduire du plafond de 20 jours ouvrés par an auxquels la salariée pouvait prétendre 12 jours ouvrés de congés acquis sur des périodes de références antérieures (2021 et 2022). Et ce, au motif que ces jours de congés, qui n’avaient pas pu être posés en raison de plusieurs arrêts de travail, avaient été reportés sur l’année 2023 et fait l’objet d’une indemnité réglée à la salariée lors de son départ de l’entreprise.
Mais pour la Cour de cassation, ce plafond de 20 jours ouvrés (ou 24 jours ouvrables) s’apprécie par période de référence. Autrement dit, il ne doit pas tenir compte des jours de congés payés qui ont été acquis sur des périodes de référence antérieures et qui ont été reportés.
Rappel : : la période de référence permettant l’acquisition de congés payés s’étend généralement du 1 juin au 31 mai de l’année suivante.

Crée le 04-02-2026
Budget 2026 : du changement pour le Plan d’épargne retraite
FiscalPatrimoineFiscalité personnellePlacementAvantages fiscauxLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableInstagramActualitéLa loi de finances pour 2026 modifie le régime du Plan d’épargne retraite en prolongeant de 2 ans la durée de report des plafonds de déductibilité non utilisés.
Fabrice Gomez
Après quelques semaines d’attente, la France est enfin dotée d’un budget pour 2026 (il ne reste plus qu’à passer la barrière du Conseil constitutionnel). Relativement pauvre, la loi de finances pour 2026 introduit néanmoins un certain nombre de mesures nouvelles intéressant les particuliers. L’une d’entre elles concerne le Plan d’épargne retraite (PER). Explications.
Parmi ses nombreux atouts, le Plan d’épargne retraite offre un régime fiscal favorable. En effet, les sommes versées volontairement sur un PER individuel sont déductibles fiscalement des revenus imposables de l’assuré. À noter qu’il s’agit d’une option puisque chacun peut choisir de ne pas profiter de cet avantage fiscal à « l’entrée » afin de bénéficier d’une fiscalité plus réduite à « la sortie ».
Toutefois, cette déductibilité est plafonnée. Les plafonds de l’épargne retraite étant calculés automatiquement chaque année par l’administration fiscale et pour chaque membre du foyer fiscal. Ces plafonds sont d’ailleurs indiqués dans l’avis d’imposition des contribuables. Dans le détail, est indiqué le plafond de l’année en cours mais aussi ceux des 3 dernières années. Et si, au bout de 3 ans, l’épargnant n’utilise pas entièrement ses plafonds, ces derniers sont perdus définitivement.
Mais bonne nouvelle ! La loi de finances pour 2026 étend la durée de report des plafonds de déduction non utilisés de 3 à 5 ans.
La loi de finances introduit un autre changement : les versements effectués sur un PER par un assuré à compter de son 70 anniversaire ne sont plus déductibles de ses revenus. Selon les pouvoirs publics, cette suppression a pour but de recentrer l’avantage fiscal sur la période active de préparation de la retraite et de limiter l’utilisation du Plan d’épargne retraite comme un outil de défiscalisation. Toutefois, en pratique, cette suppression ne devrait pas avoir un impact majeur car les stratégies d’alimentation de PER à partir de 70 ans concernent a priori assez peu d’assurés. Toutefois, une réflexion mérite d’être menée par les foyers fortement fiscalisés en vue d’organiser leurs versements et de tirer profit des avantages fiscaux avant cette année charnière.
Précision : : ces nouvelles mesures s’appliquent à compter du 1 janvier 2026.

Crée le 05-02-2026
Bientôt la taxe 2026 sur les bureaux en Île-de-France et en Provence-Côte d’Azur
FiscalFiscalité professionnelleTaxes diversesLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoAssociationsActualitéLa taxe annuelle sur les bureaux, sur les locaux commerciaux et de stockage ainsi que sur les surfaces de stationnement situés en Île-de-France ou en Provence-Côte d’Azur doit être déclarée et payée au plus tard le 28 février 2026.
Marion Beurel
Une taxe annuelle s’applique sur les locaux à usage de bureaux, sur les locaux commerciaux, sur les locaux de stockage et sur les surfaces de stationnement situés en région Île-de-France ou dans les départements des Bouches-du-Rhône (13), du Var (83) et des Alpes-Maritimes (06), sauf exonérations.
Cette taxe est due, en principe, par les personnes (y compris les associations) propriétaires, au 1 janvier de l’année d’imposition, de tels locaux. Son montant étant égal à la superficie en m des locaux concernés multipliée par un tarif variable en fonction de leur nature et/ou de leur localisation.
Les tarifs de cette taxe pour 2026 sont les suivants :
En pratique, les redevables de cette taxe doivent déposer une déclaration n° 6705 B, accompagnée du paiement correspondant, avant le 1 mars de chaque année, auprès du comptable public du lieu de situation des locaux. Pour les impositions dues au titre de 2026, ces démarches doivent être effectuées au plus tard le 28 février prochain.
| Tarifs par m |
|||||
| Localisation | Île-de-France |
Provence-Côte d’Azur | |||
| Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | ||
| Bureaux |
26,11 € | 21,99 € | 12,03 € | 5,82 € | 1,01 € |
| Locaux commerciaux | 8,96 € | 8,96 € | 4,66 € | 2,39 € | 0,42 € |
| Locaux de stockage | 4,69 € | 4,69 € | 2,39 € | 1,23 € | 0,23 € |
| Surface de stationnement |
2,96 € | 2,96 € | 1,61 € | 0,85 € | 0,16 € |
| (1) Zone 1 (1 |
|||||
À noter : : ne sont pas taxables, notamment, les bureaux d’une superficie inférieure à 100 m, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 m, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 m et les surfaces de stationnement de moins de 500 m.

Crée le 05-02-2026
Visio, le logiciel de visioconférence français qui veut remplacer les outils américains
MultimédiaLe Guide du Chef d-EntrepriseTendancesMultiMédiaBoucle VidéoAssociationsActualitéPour assurer la souveraineté de la France et sortir de la dépendance aux outils américains, le gouvernement vient d’annoncer la généralisation de Visio, un outil de visioconférence conçu en France et destiné à l’ensemble des services de l’État d’ici 2027.
Isabelle Capet
Développé par la direction interministérielle du numérique (DINUM), Visio pourrait rapidement remplacer les Teams, Zoom, GoTo Meeting et autres Webex auprès des agents de l’État. C’est déjà en partie le cas pour les agents et chercheurs du Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Visio permettrait alors de réaliser plusieurs millions d’euros d’économies par an, actuellement dépensés dans l’achat de licences à des acteurs non-européens.
Concrètement, Visio dispose d’une interface simple et efficace pour lancer la visioconférence. Une fonction permet, en outre, de sous-titrer en direct les échanges et de rédiger un résumé de la conversation grâce à des technologies françaises. Le logiciel est intégré dans la Suite numérique de l’État, qui comprend également une messagerie instantanée, Tchap, ainsi qu’un drive pour stocker et modifier ses fichiers. L’arrivée d’une IA souveraine, en partenariat avec Mistral, est également prévue d’ici la fin de l’année.
Pour en savoir plus :

Crée le 04-02-2026
Barème de l’impôt sur le revenu : ce que prévoit le projet de loi de finances pour 2026
PatrimoineFiscalLe Guide du Chef d-EntrepriseFiscalitéFiscalité personnelleImpots sur le revenuBoucle VidéoInstagramActualitéLe projet de loi de finances pour 2026 revalorise notamment les tranches du barème de l’impôt sur le revenu de 0,9 %.
Fabrice Gomez
Adopté définitivement, le projet de loi de finances pour 2026 procède à une réévaluation du barème de l’impôt sur le revenu.
Afin de protéger le pouvoir d’achat des Français, les limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu 2025, qui sera liquidé en 2026, sont revalorisées de 0,9 % afin de prendre en compte l’inflation. Le barème est donc le suivant :
De la même façon, le plafonnement des effets du quotient familial est relevé, pour l’imposition des revenus de 2025, de 1 791 à 1 807 € pour chaque demi-part accordée, soit 904 € (au lieu de 896 €) par quart de part additionnel.
| IMPOSITION DES REVENUS 2025 | |
| Fraction du revenu imposable (une part) | Taux d’imposition |
| Jusqu’à 11 600 € | 0 % |
| De 11 601 € à 29 579 € | 11 % |
| De 29 580 € à 84 577 € | 30 % |
| De 84 578 € à 181 917 € | 41 % |
| Plus de 181 917 € | 45 % |
Précision : : le quotient familial est un système qui corrige la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu pour les contribuables ayant droit à plus d’une part. Toutefois, l’avantage fiscal qui résulte de son application est limité pour chaque demi-part ou quart de part s’ajoutant aux deux parts des couples mariés ou pacsés faisant l’objet d’une imposition commune ou à la part des contribuables célibataires, divorcés, mariés ou pacsés imposés séparément.

Crée le 02-02-2026
Respectez bien les temps de pause de vos salariés
AutresSocialConditions de travailJurisprudenceLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoAssociationsActualitéLe salarié dont l’employeur ne respecte pas les temps de pause peut obtenir des dommages-intérêts en justice sans avoir à prouver que ce manquement lui a causé un préjudice.
Coralie Carolus
Les salariés doivent, en principe, bénéficier d’une pause d’au moins 20 minutes consécutives dès lors que leur temps de travail quotidien atteint 6 heures. Et attention, en cas de non-respect de ses temps de pause par l’employeur, le salarié peut obtenir des dommages-intérêts en justice.
Dans une affaire récente, un salarié avait réclamé en justice des dommages-intérêts à son ancien employeur au motif, notamment, que ce dernier n’avait « pas toujours » respecté ses temps de pause.
Saisie du litige, la Cour d’appel de Poitiers n’avait pas fait droit à la demande du salarié dans la mesure où celui-ci n’avait pas prouvé que le non-respect de ses temps de pause lui avait causé un préjudice. Ce dernier s’étant, selon les juges, « borné » à leur indiquer que le manquement de son employeur avait contribué à dégrader son état de santé.
Mais pour la Cour de cassation, il n’est pas nécessaire au salarié de prouver qu’il a subi un préjudice. Le seul constat du non-respect des temps de pause par son employeur lui ouvre droit à des dommages-intérêts.
À noter : : les juges appliquent le même principe, notamment, lorsque l’employeur ne respecte pas la durée quotidienne maximale de travail (), la durée hebdomadaire maximale du travail de nuit () ou fait travailler un salarié durant un arrêt de travail ().

Crée le 03-02-2026
Où doit se dérouler une vérification de comptabilité ?
FiscalLe Guide du Chef d-EntrepriseContrôle fiscalFiscalité professionnelleBoucle VidéoAssociationsActualitéSi une vérification de comptabilité doit, en principe, avoir lieu dans les locaux de l’entreprise contrôlée, elle peut aussi être délocalisée, à l’initiative de l’entreprise ou de l’administration fiscale.
Marion Beurel
En principe, une vérification de comptabilité doit se dérouler sur place, c’est-à-dire dans les locaux du principal établissement de l’entreprise, afin de permettre au vérificateur d’apprécier les conditions d’exploitation et de recueillir les informations et observations de l’entreprise contrôlée. Toutefois, la vérification peut aussi se tenir ou se poursuivre en dehors de ces locaux, à l’initiative de l’entreprise ou de l’administration fiscale, dans tout autre lieu déterminé d’un commun accord entre les intéressés. Ce changement de lieu pouvant être décidé avant le début du contrôle, donc dès l’envoi de l’avis de vérification, ou en cours de contrôle.
À ce titre, l’administration fiscale a précisé que le nouveau lieu du contrôle peut se situer chez un tiers si les conditions d’accueil sont satisfaisantes et permettent de garantir la confidentialité des échanges.
Sachant qu’à défaut d’accord avec l’entreprise ou son conseil, l’administration peut décider d’effectuer le contrôle dans ses propres locaux, à savoir dans les locaux du service de contrôle ou dans des locaux administratifs proches du lieu de situation de l’entreprise.
Que la vérification ait lieu dans l’entreprise ou dans un autre endroit où se trouvent les documents comptables, le vérificateur peut en prendre copie. Et attention, l’entreprise ne peut pas s’y opposer, sous peine d’une amende de 1 500 € par document, dans une limite globale de 50 000 €.
Exemple : : le contrôle peut ainsi se dérouler au cabinet de l’expert-comptable ou de l’avocat de l’entreprise ou encore dans les locaux d’une autre société du groupe.
À savoir : : cette possibilité de délocalisation est également prévue pour les contrôles sur place des reçus émis par les associations pour les dons ouvrant droit à réduction d’impôt.
Précision : : le vérificateur ne peut pas emporter les documents comptables originaux de l’entreprise, sauf si cette dernière le demande. Tel peut être le cas lorsque l’entreprise souhaite que le contrôle se déroule dans les bureaux de l’administration. En pratique, l’entreprise doit proposer le déplacement de la comptabilité via une demande écrite préalable. Et le vérificateur doit lui remettre un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées.

Crée le 02-02-2026
Vente de la résidence principale d’un entrepreneur individuel en liquidation
TransversauxJuridiqueAutresDéfaillance d-entrepriseJurisprudenceLe Guide du Chef d-EntrepriseEntreprise individuelleGaranties/SûretésBoucle VidéoActualitéLorsqu’un entrepreneur individuel est mis en liquidation judiciaire et que cette procédure de liquidation affecte tant son patrimoine professionnel que son patrimoine personnel, le liquidateur peut être autorisé à vendre la résidence principale de l’intéressé, mais au seul profit de ses créanciers personnels.
Christophe Pitaud
Depuis une loi du 14 février 2022, les entrepreneurs individuels disposent de deux patrimoines distincts :- un patrimoine professionnel, composé des biens « utiles » à leur activité, qui constitue le gage de leurs créanciers professionnels ;- et un patrimoine personnel, composé des autres biens, notamment la résidence principale (ou la partie de celle-ci qui n’est pas utilisée pour l’exercice de l’activité professionnelle), qui constitue le gage de leurs créanciers personnels.
Avantage de cette séparation : seul le patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel peut être saisi par ses créanciers professionnels, son patrimoine personnel (donc sa résidence principale ou la partie de celle-ci qui n’est pas utilisée pour l’exercice de son activité professionnelle) étant, quant à lui, à l’abri des poursuites de ces derniers.
À ce titre, interrogée sur l’articulation de ces dispositions, la Cour de cassation vient de préciser (dans un avis) que lorsqu’une procédure collective est ouverte tant sur le patrimoine professionnel que sur le patrimoine personnel d’un entrepreneur individuel, le liquidateur judiciaire peut être autorisé par le juge à vendre la résidence principale de ce dernier mais au seul profit de ses créanciers personnels.
Précision : : lorsque les dettes d’un entrepreneur individuel concernent tant son patrimoine personnel que son patrimoine professionnel, le tribunal peut ouvrir une procédure collective (redressement, liquidation judiciaire) pour le traitement de ses dettes concernant son patrimoine professionnel et saisir la commission de surendettement pour ses dettes concernant son patrimoine personnel. Sachant toutefois que la procédure collective peut concerner les deux patrimoines lorsque, par exemple, ils ne sont pas bien distincts ou lorsqu’un créancier professionnel dispose d’un gage sur le patrimoine personnel. C’est dans cette dernière hypothèse (procédure collective concernant les deux patrimoines) que la Cour de cassation a été appelée à donner un avis sur la vente par le liquidateur de la résidence principale d’un entrepreneur individuel.

Crée le 29-01-2026
Associations : il est temps de déclarer vos activités de représentation d’intérêts
JuridiqueLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableAssociationsActualitéLes associations inscrites sur le répertoire des représentants d’intérêts qui ont clôturé leur exercice au 31 décembre 2025 doivent, d’ici le 31 mars 2026, déclarer les actions de représentation d’intérêts conduites en 2025.
Sandrine Thomas
Les associations qui œuvrent en tant que représentant d’intérêts doivent s’inscrire sur le géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Ce répertoire, consultable sur le , vise à informer les citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics.
Une association est un représentant d’intérêts lorsque l’activité d’un de ses dirigeants, de ses salariés ou de ses membres consiste, de façon principale ou régulière, à entrer en communication, à son initiative, avec des responsables publics, aux niveaux national et/ou local, afin d’influer sur des décisions publiques en projet ou en vigueur, qu’elles soient générales ou individuelles (lois, décrets, contrats de concession, marchés publics, décisions individuelles ayant pour objet la délivrance, la modification, le retrait ou le renouvellement d’un agrément ou d’une autorisation, autorisations temporaires d’occupation du domaine public...).
Cette activité est exercée :- à titre principal si, au cours des 6 derniers mois, la personne a consacré plus de la moitié de son temps à des actions de représentation d’intérêts ;-à titre régulier si, dans les 12 derniers mois, elle a réalisé plus de 10 de ces actions.
Les associations qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2025 doivent, via le site de la et d’ici le 31 mars 2026, déclarer les actions de représentation d’intérêts conduites en 2025.
Concrètement, doivent notamment être communiquées les informations portant sur :- le type de décisions publiques sur lesquelles l’association a fait porter ses actions de représentation d’intérêts ;- l’objet et le domaine d’intervention de ces actions ;- le type d’actions effectuées ;- les catégories de responsables publics avec lesquelles l’association est entrée en communication sans mentionner l’identité ou la fonction précisément occupée ;- le montant des dépenses consacrées à ces actions, soit le montant de l’ensemble des moyens humains, matériels et financiers mobilisés pour mener ses activités.
Précision : : sont des responsables publics notamment les membres du gouvernement et des cabinets ministériels, les députés, les sénateurs, les collaborateurs parlementaires, les directeurs généraux de certaines autorités administratives (Défenseur des droits, Haute Autorité de santé, Cnil...), les préfets, les présidents et membres des conseils régionaux ou départementaux, le président du conseil de la métropole de Lyon, les maires d’une commune de plus de 100 000 habitants, etc.
Illustrations : : sont des actions de représentation d’intérêts notamment l’organisation de discussions informelles, de réunions en tête-à-tête, de débats ou d’évènements, une correspondance régulière (courriers, courriels, SMS…), l’envoi de pétitions, de lettres ouvertes ou de tracts, la transmission de suggestions afin d’influencer la rédaction d’une décision publique ou les interpellations directes et nominatives sur un réseau social.
Attention : : le fait, pour un représentant d’intérêt, de ne pas communiquer ces informations est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Crée le 29-01-2026
OETH : les dépenses de partenariat de nouveau déductibles
SocialAllègements exonérationsLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableAssociationsActualitéLes entreprises soumises à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés peuvent continuer à déduire les dépenses liées à des partenariats conclus avec des organismes œuvrant pour la formation et l’insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées.
Sandrine Thomas
Les entreprises qui comptent au moins 20 salariés doivent employer des travailleurs handicapés dans une proportion d’au moins 6 % de leur effectif total. Celles qui ne respectent pas cette obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) doivent verser une contribution financière annuelle.
Les entreprises peuvent toutefois déduire certaines dépenses de cette contribution et, notamment :- celles qu’elles ont directement engagées pour la réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre leurs locaux accessibles aux travailleurs handicapés ou pour le maintien dans l’emploi des bénéficiaires de l’OETH… ;- celles liées à la conclusion de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de services avec des travailleurs indépendants handicapés, des entreprises adaptées ou des établissements ou services d’accompagnement par le travail.
Jusqu’au 31 décembre 2024, pouvaient également être déduites, dans la limité de 10 % de la contribution financière, les dépenses exposées par un employeur au titre du partenariat, par voie de convention ou d’adhésion, avec des associations ou des organismes œuvrant pour la formation et l’insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées que l’employeur accueille ou embauche, à l’exclusion des opérations de mécénat.
La possibilité de déduire de telles dépenses, toujours dans la limite de 10 %, vient d’être prolongée pour celles réalisées entre le 1 janvier 2025 et le 31 décembre 2029.
Une nouvelle condition est cependant introduite. Ainsi, pour pouvoir déduire ses dépenses de partenariat, l’entreprise doit, au titre de l’année considérée, justifier avoir conclu avec un bénéficiaire de l’OETH accompagné par l’association ou l’organisme, un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois, un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou une convention de stage d’au moins 6 mois.
Les associations ou organismes doivent communiquer aux entreprises, avec lesquelles un partenariat a été conclu la liste des bénéficiaires de l’OETH ayant signé un tel contrat ou une telle convention. Et ce, au plus tard le 15 mars de l’année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative de l’OETH est effectuée (par exemple, le 15 mars 2026 pour la déclaration à effectuer dans la DSN d’avril 2026 au titre de l’OETH de 2025).
En pratique : : la déclaration annuelle relative à l’OETH de 2025 et, le cas échéant, le paiement de la contribution financière devront être effectués dans la DSN d’avril 2026 transmise le 5 ou le 15 mai 2026 (selon l’effectif de l’entreprise).
À noter : : ces associations ou organismes doivent, chaque année avant le 30 juin, transmettre au ministre chargé de l’emploi, un bilan de l’impact des partenariats conclus sur l’emploi direct des bénéficiaires de l’OETH.

Crée le 30-01-2026
L’assurance-vie, grande gagnante en 2025
PatrimoineLe Guide du Chef d-EntrepriseAssurance-viePlacementBoucle VidéoActualitéEn 2025, l’assurance-vie a atteint une collecte nette record de 50,6 milliards d’euros, un niveau inégalé depuis 2010.
Fabrice Gomez
L’année 2025 a été un bon cru pour l’assurance-vie. En effet, d’après les chiffres publiés récemment par France Assureurs, la collecte nette en 2025 s’est élevée à 50,6 Md€, soit 22,1 Md€ de plus qu’en 2024. La barre des 50 Md€ n’avait pas été franchie depuis 2010 !
Cette collecte nette positive concerne à la fois les supports en unité de compte (+42,5 Md€) et les supports en euros (+8,1 Md€). Pour ces derniers, la collecte nette redevient donc positive après 5 années consécutives de décollecte. À noter que l’encours en assurance-vie a atteint 2 107 Md€ à fin décembre 2025, en hausse de +6,1 % (+122 Md€ sur un an).
Comme l’indique le directeur général de France Assureurs : « ».
D’après France Assureurs, sur un patrimoine financier de 3 620 Md€ (hors titres, billets, pièces, créances d’assurance non-vie, crédits, dépôts dans les banques étrangères, cautionnements divers…), l’assurance-vie représente plus de la moitié (54 %) des principaux placements financiers des Français en 2025. Viennent ensuite les dépôts et livrets soumis à l’impôt (19 %), le Livret A et le LDDS (15 %), suivis du Plan d’épargne logement (5 %) et des comptes à terme (4 %). Globalement, en France, 20 millions de personnes détiennent 57 millions de contrats d’assurance-vie, dont l’encours médian s’élève à 35 000 €.
Il faut dire que l’attrait des Français pour l’assurance-vie s’est renforcé ces dernières années du fait notamment de l’amélioration du rendement des fonds en euros. Pour 2025, le rendement moyen de ces derniers devrait tourner autour de 2,7 %, soit 1,5 point de plus qu’en 2020 et 2021. Durant ces années, le rendement avait atteint un point bas en raison de la faiblesse des taux des obligations d’État, tombées en territoire négatif.
Autre facteur, l’assurance-vie a également profité de la baisse des taux de l’épargne réglementée. Ainsi, par exemple, le taux du Livret A est passé de 3 % au 1 février 2023 à 1,7 % au 1 août 2025. Résultat : le Livret A a enregistré l’année dernière une décollecte nette de plus de 2 Md€. Une première en 10 ans !
Précision : : les supports en unité de compte représentent 32 % de l’encours en assurance-vie à fin 2025, soit 13 points de plus qu’il y a 20 ans.

Crée le 30-01-2026
Opposition à contrôle fiscal : gare à l’attitude du dirigeant !
AutresFiscalFiscalité professionnelleContrôle fiscalLe Guide du Chef d-EntrepriseJurisprudenceBoucle VidéoAssociationsActualitéL’attitude d’un dirigeant peut caractériser une opposition à contrôle fiscal justifiant l’application d’une majoration de 100 %.
Marion Beurel
Lorsqu’un contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable, l’administration peut établir « d’office » le redressement d’impôt et l’assortir d’une majoration de 100 %. Une sanction lourde qui doit amener les dirigeants à être vigilants sur leur attitude et à coopérer lors d’un contrôle fiscal, comme l’illustre une récente affaire.
Une société civile était l’unique associé d’une SCI. Ces deux sociétés avaient chacune fait l’objet d’une vérification de comptabilité. Alors que la vérification de la SCI s’était déroulée sans difficulté, celle de la société civile s’était soldée par un échec du fait du comportement de son dirigeant. En effet, ce dernier ne s’était pas présenté aux rendez-vous convenus avec le vérificateur et avait refusé, de façon répétée, de présenter la comptabilité de la société, et ce malgré deux mises en garde. Une attitude caractérisant une opposition à contrôle fiscal, selon l’administration, qui avait donc taxé d’office la société et mis à sa charge la majoration de 100 %. Un redressement qui a été confirmé par les juges.
Précision : : le dirigeant avait contesté l’application de la majoration, considérant qu’il n’avait pas empêché le contrôle fiscal de la société civile dans la mesure où les seuls bénéfices de celle-ci provenaient de la SCI. Et puisque la SCI avait pu faire l’objet d’une vérification sur place, il estimait que la propre vérification de la société civile était inutile. Mais, selon les juges, le contribuable n’avait pas à apprécier l’opportunité d’une vérification à son égard.
Conseil d’État, 3 octobre 2025, n° 501373
Cour administrative d’appel de Nancy, 19 décembre 2024, n° 22NC00068

Crée le 29-01-2026
Des crédits à la consommation accordés par les entreprises
JuridiqueContratsCommerce/ConsommationLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoActualitéLes entreprises pourront prochainement accorder des crédits à la consommation à leurs clients lorsque ces crédits seront complémentaires à la vente ou à la location des biens ou des services qu’elles offrent.
La Rédaction
À compter du 20 novembre 2026, les entreprises qui vendent des biens ou des services seront en droit, à titre accessoire de leur activité, d’accorder un crédit à la consommation à leurs clients lorsque ce crédit sera complémentaire à la vente ou à la location d’un bien ou d’un service qu’elles offrent.
Pour pouvoir consentir des prêts à la consommation, certaines entreprises devront s’immatriculer sur un registre spécifique. Seront concernées les entreprises :- qui dépassent au moins deux des trois seuils suivants : 25 M€ de bilan, 50 M€ de chiffre d’affaires et 250 salariés ;- qui ne dépassent pas les seuils ci-dessus, mais qui octroient des crédits ou des paiements différés avec intérêts pour lesquels les frais éventuels dus en cas de retard de paiement ne sont pas limités.
Rappel : : seuls les établissements de crédit sont aujourd’hui autorisés à octroyer des crédits à la consommation. Les entreprises pouvant toutefois, dans le cadre de leur activité, consentir des délais de paiement.
Précision : : les conditions d’immatriculation sur ce registre et les modalités de sa tenue seront déterminées par un décret à paraître.

Crée le 28-01-2026
Projet de loi de finances pour 2026 : que propose le nouveau statut du bailleur privé ?
PatrimoineFiscalFiscalité immobilièreLe Guide du Chef d-EntrepriseImmobilierFiscalitéFiscalité personnelleAvantages fiscauxBoucle VidéoInstagramActualitéAfin de relancer le secteur de l’immobilier, les pouvoirs publics proposent, au sein du projet de loi de finances pour 2026, un dispositif permettant aux bailleurs de pratiquer un amortissement du prix d’acquisition du logement loué nu.
Fabrice Gomez
Faute d’avoir trouvé un compromis avec les principaux groupes politiques, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, s’est résolu à déclencher la procédure de l’article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le budget 2026. Un budget qui, selon l’Exécutif, trouverait à s’appliquer dans le meilleur des cas à la mi-février, à condition que le texte passe le barrage des dernières motions de censure et d’éventuelles saisines du Conseil Constitutionnel…
Au final, la copie du projet de budget contient plusieurs mesures destinées à relancer le secteur de l’immobilier et de la construction en difficulté grâce, notamment, à la création d’un nouveau statut du bailleur privé (baptisé dispositif « Relance logement » ou « Jeanbrun »). Une bonne occasion de passer en revue ce qu’il prévoit.
Applicable sur l’ensemble du territoire, le dispositif Jeanbrun permettrait aux propriétaires bailleurs, soumis au régime réel foncier, qui louent nu, à titre de résidence principale, un logement appartenant à un bâtiment d’habitation collectif, neuf (ou en VEFA) ou ancien réhabilité, de pratiquer, sur leurs revenus fonciers, un amortissement du prix d’acquisition de ce logement. Sachant que l’amortissement ne pourrait être pratiqué que sur 80 % du prix d’acquisition, majoré, le cas échéant, du montant des travaux réalisés s’il s’agit d’un bien ancien (la valeur du foncier étant fixée forfaitairement à 20 % du prix d’acquisition nets de frais).
Il faut également savoir que le taux et le plafond applicables à l’amortissement varieraient en fonction de la nature de la location. L’objectif du législateur étant de favoriser les logements neufs et les locations proposées dans le secteur social (cf. tableau ci-dessous).
Autre condition, le bailleur devrait s’engager à louer le logement, de manière continue et effective, pendant au moins 9 années. Cette mise en location devant être effectuée dans les 12 mois suivant la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou dans les 12 mois suivant la date d’achèvement des travaux. En outre, le bailleur devrait respecter des plafonds de loyer et de ressources des locataires.
Information importante, le dispositif Jeanbrun ne pourrait pas se cumuler avec certains autres dispositifs comme les dispositifs Denormandie ou encore Malraux.
Sachant, enfin, que le dispositif devrait s’appliquer aux acquisitions de logements réalisées entre le lendemain de la publication de la loi de finances pour 2026 (probablement en février 2026) et le 31 décembre 2028.
En outre, les bailleurs pourraient imputer sur leur revenu global le déficit foncier résultant de l’amortissement (et de leurs autres dépenses déductibles sauf intérêts d’emprunt) jusqu’à 10 700 €.
Par ailleurs, le projet de loi de finances pour 2026 prévoit de prolonger le doublement de ce plafond (soit 21 400 € au lieu de 10 700 €) pour les travaux de rénovation énergétique dans une passoire thermique réalisés jusqu’au 31 décembre 2027.
| Dispositif Jeanbrun | ||||||
| Secteur intermédiaire | Secteur social | Secteur très social | ||||
| Taux d’amortissement | 3,5 % pour un logement neuf | 3 % pour un logement ancien | 4,5 % pour un logement neuf | 3,5 % pour un logement ancien | 5,5 % pour un logement neuf | 4 % pour un logement ancien |
| Plafond de l’amortissement | 8 000 € par an et par foyer fiscal | 10 000 € par an et par foyer fiscal | 12 000 € par an et par foyer fiscal | |||
Précision : : les travaux sur un bien ancien doivent satisfaire aux critères d’une réhabilitation lourde (obtention d’un DPE A ou B) et représenter au moins 30 % du prix d’acquisition du logement.
Précision : : le locataire ne pourrait pas être un membre du foyer fiscal du bailleur, ni un parent ou un allié jusqu’au 2 degré inclus.
Projet de loi de finances pour 2026, texte sur lequel le gouvernement engage sa responsabilité

Crée le 29-01-2026
Un podcast pour savoir utiliser l’IA en entreprise
MultimédiaLe Guide du Chef d-EntrepriseMultiMédiaTendancesBoucle VidéoAssociationsActualitéLe podcast « Les PME & l’IA : histoires vécues » propose, en 40 minutes deux fois par mois, de découvrir des cas d’usages concrets de l’Intelligence artificielle en entreprise, au travers de témoignages d’entrepreneurs et d’experts qui les accompagnent.
Isabelle Capet
Lancé par Jean-François Deldon, président de Yakadata, Ambassadeur Osez l’IA et Activateur France Num, le podcast « Les PME & l’IA : histoires vécues » donne la parole à ceux qui soutiennent l’entrée de l’IA dans les entreprises. Pas de langue de bois dans ce podcast, l’objectif est de ne rien cacher des réussites, mais aussi des échecs de l’intégration de l’IA dans les TPE-PME. À travers des échanges avec des dirigeants et salariés de TPE-PME ou encore avec des organismes qui aident les entreprises à se lancer dans l’IA, on en apprend plus sur combien coûte un projet IA, comment financer son projet ou encore comment embarquer les équipes.
Le dernier épisode, en date du 9 janvier 2026, est, par exemple, consacré à « comment passer à l’action dans ses projets numériques & IA avec France Num ». L’invité est Alexandre Streicher, Chef de projet au sein de l’initiative France Num, le dispositif public qui accompagne les TPE et PME dans leur digitalisation. Dans ce podcast sont notamment abordés les missions de France Num, les freins des dirigeants : temps, compétences, confiance, financement, ou encore les aides et financements disponibles (subventions, prêts, dispositifs régionaux).
Pour en savoir plus :

Crée le 27-01-2026
Bail rural : gare à l’obligation d’exploiter personnellement le fonds loué !
AutresJuridiqueJurisprudenceLe Guide du Chef d-EntrepriseContratsBoucle VidéoImmanquableActualitéL’exploitant agricole qui a régulièrement recours aux services d’une entreprise pour effectuer des travaux sur les terres louées à tel point qu’il peut être considéré comme ayant cessé de les exploiter personnellement s’expose à la résiliation de son bail.
Christophe Pitaud
En raison notamment de l’augmentation de la taille des exploitations et du coût du matériel agricole, de plus en plus d’exploitants agricoles ont recours aux services d’entreprises de travaux agricoles. Or lorsqu’ils sont locataires, les agriculteurs ont l’obligation d’exploiter personnellement les parcelles qu’ils louent. À défaut, ils encourent la résiliation de leur bail rural.
Le recours trop important ou trop fréquent à des prestataires de travaux agricoles par un locataire est donc de nature à constituer un motif pour le bailleur de faire résilier le bail. En effet, ce dernier pourrait lui reprocher de ne pas satisfaire à son obligation d’exploiter personnellement les biens loués.
Saisis d’un litige en la matière, les juges doivent donc apprécier si le locataire mis en cause par son bailleur recourt de façon excessive aux services de prestataires de travaux agricoles à un point tel qu’il a perdu de ce fait la maîtrise et la disposition de l’exploitation des biens loués.
Ainsi, dans une affaire jugée en 2024, les juges avaient considéré que l’exploitant qui faisait appel à une entreprise pour effectuer l’ensemble des travaux de l’exploitation et sur l’intégralité des parcelles louées, et ce en vertu d’un contrat d’un an, renouvelable tacitement, avait perdu la maîtrise et la disposition de son exploitation et qu’il devait donc être considéré comme ayant cessé d’exploiter personnellement les terres louées. Pour les juges, la résiliation du bail pour ce motif était donc justifiée.
Plus récemment, les juges ont, à l’inverse, refusé de prononcer la résiliation du bail d’un exploitant qui, certes, faisait régulièrement appel à des prestataires de services pour l’assister dans son exploitation, mais qui avait néanmoins « conservé la maîtrise et la disposition des terres louées ». À l’appui de leur décision, les juges ont relevé notamment que cet exploitant, bien qu’exerçant par ailleurs la profession d’aide-soignant :- était régulièrement vu en train de conduire un tracteur pour réaliser divers travaux tels que la préparation des semailles, le broyage des cailloux ainsi que le transport de céréales et de pailles ;- avait loué un automoteur afin d’effectuer par lui-même des traitements et de l’épandage ;- achetait régulièrement des semences et des produits phytosanitaires.

Crée le 27-01-2026
Pas de suppression anticipée pour la CVAE !
FiscalFiscalité professionnelleTaxes locales/Impôts locauxLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableInstagramAssociationsActualitéLe projet de loi de finances pour 2026, dans sa version après recours à l’article 49.3 de la Constitution, ne prévoit plus d’avancer de 2 ans la suppression progressive de la CVAE, qui reste donc gelée pour 2026 et 2027.
Marion Beurel
On se souvient que la loi de finances pour 2025 a gelé la suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui était initialement prévue jusqu’en 2027, pour la reporter sur les années 2028 et 2029 avec une disparition totale en 2030.
Cependant, souhaitant faire un geste en direction des entreprises, le gouvernement avait prévu, dans le projet de budget 2026, d’avancer cette suppression de 2 ans et donc de réamorcer la baisse de la CVAE dès 2026.
Finalement, à la recherche d’économies pour financer les diverses concessions consenties aux oppositions, le gouvernement a retiré cette mesure du projet de loi de finances pour 2026 dans sa version après recours à l’article 49.3 de la Constitution.
Ainsi, sauf nouveau changement dans les mois ou années qui viennent, le taux d’imposition maximal pour 2026 et 2027 restera fixé à 0,28 %, avant d’être abaissé à 0,19 % en 2028 et à 0,09 % en 2029. La CVAE n’étant totalement supprimée qu’en 2030.
Corrélativement, le taux du plafonnement de la CET est maintenu à 1,531 % de la valeur ajoutée pour 2026 et 2027, puis diminuera à 1,438 % en 2028 et à 1,344 % en 2029. À compter de 2030, ce plafonnement ne concernera plus que la CFE et son taux sera ramené à 1,25 %.
Si son taux d’imposition reste gelé, le montant de la CVAE pourrait toutefois varier pour une tout autre raison. En effet, l’Autorité des normes comptables a adopté un nouveau règlement modifiant le plan comptable général (PCG), et notamment la définition du résultat exceptionnel. Désormais, ce résultat est limité principalement aux produits et aux charges directement liés à un événement majeur et inhabituel. Certaines opérations concourant au résultat exceptionnel ont donc basculé vers le résultat d’exploitation (cessions d’immobilisations, subventions d’investissement…).
Une modification qui impacte également les éléments (produits ou charges) retenus pour le calcul de la valeur ajoutée servant d’assiette à la CVAE, a récemment confirmé l’administration fiscale.
Rappel : : la CVAE, est, avec la cotisation foncière des entreprises (CFE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET).
Attention : : à l’heure où nous écrivions ces lignes, seule la première partie (la partie recettes) du projet de loi de finances avait été considérée comme adoptée après le rejet des motions de censure déposées par certaines oppositions. Le gouvernement a également engagé sa responsabilité au titre de l’article 49.3 pour la seconde partie (la partie dépenses) et pour l’ensemble du projet. Le projet de loi de finances ne sera donc définitivement adopté qu’après rejet des éventuelles motions de censure qui seront déposées.
Précision : : lorsque la CET dépasse un certain pourcentage de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement (appelé « plafonnement »).
Important : : ces changements s’appliquant obligatoirement aux exercices ouverts depuis le 1 janvier 2025, les entreprises doivent en tenir compte, le cas échéant, dans leur clôture comptable 2025.

Crée le 26-01-2026
L’action en revendication d’un bien vendu avec réserve de propriété
AutresJuridiqueLe Guide du Chef d-EntrepriseGaranties/SûretésJurisprudenceContratsBoucle VidéoAssociationsActualitéLorsqu’un bien a été vendu avec réserve de propriété jusqu’au paiement intégral du prix, le vendeur peut revendiquer le bien en cas de défaut de paiement du prix par l’acheteur même si la créance du prix de vente est prescrite.
Christophe Pitaud
En principe, la propriété d’un bien vendu est transférée à l’acheteur dès la conclusion du contrat, que le prix soit payé ou non. Toutefois, le vendeur peut prévoir dans le contrat une clause de réserve de propriété en vertu de laquelle l’acheteur ne deviendra propriétaire du bien vendu qu’après le paiement intégral du prix. Ce qui constitue une garantie intéressante pour lui en cas d’impayé, en particulier lorsque l’acheteur fait l’objet d’une procédure collective (procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire). En effet, dans ce cas, le vendeur est en droit de récupérer son bien en exerçant une action dite en revendication.
À ce titre, les juges ont affirmé, dans une affaire récente, que l’action en revendication d’un bien vendu avec réserve de propriété en cas de défaut de paiement du prix par l’acheteur n’est pas soumise au délai de prescription de la créance. Autrement dit, le vendeur peut demander la revendication du bien (à condition de le faire dans les délais impartis) même si la créance du prix de vente est prescrite.
En effet, pour les juges, ce n’est pas parce que la créance est prescrite que l’acheteur est devenu pour autant propriétaire du bien. Tant que le prix de vente n’est pas intégralement payé, le vendeur bénéficiaire d’une clause de propriété reste propriétaire du bien et peut donc le revendiquer en cas d’impayé.
En pratique : : l’action en revendication du bien doit être exercée auprès de l’administrateur judiciaire (ou du liquidateur judiciaire en cas de liquidation) dans les 3 mois à compter de la publication du jugement ouvrant la procédure collective de l’acheteur.

Crée le 23-01-2026
Associations : quelles sont les incidences de l’absence de budget pour 2026 ?
FiscalLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableAssociationsActualitéL’absence de loi de finances pour 2026 ne permet pas de revaloriser certains montants applicables aux associations en matière de fiscalité.
Sandrine Thomas
Depuis le 1 janvier, le régime budgétaire applicable découle de la loi spéciale votée en décembre, avec pour seule vocation d’assurer la continuité des services publics avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026. En conséquence, la fiscalité applicable aux associations est actuellement régie par les dispositions antérieures à la loi spéciale.
Alors qu’il devait être revalorisé en raison de l’inflation, le barème de l’impôt sur le revenu demeure inchangé par rapport à 2025, tout au moins jusqu’à l’adoption d’un budget pour 2026. Et ce gel impacte, de facto, d’autres montants, eux-mêmes indexés sur le barème, qui restent donc, pour l’heure, identiques, notamment en matière de taxe sur les salaires, tant au niveau de son barème que de l’abattement bénéficiant aux associations.
Par ailleurs, le montant 2026 de la franchise des impôts commerciaux pour les activités accessoires des associations reste incertain en l’absence de confirmation de son montant au Bulletin officiel des Finances publiques (Bofip). Rappelons que sa revalorisation dépend de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances.
En complément : : le gouvernement a maintenu dans les mesures fiscales qu’il souhaitait voir inscrites dans la loi de finances pour 2026 le doublement du plafond de versement de la réduction d’impôt « Coluche » de 1 000 € à 2 000 €.
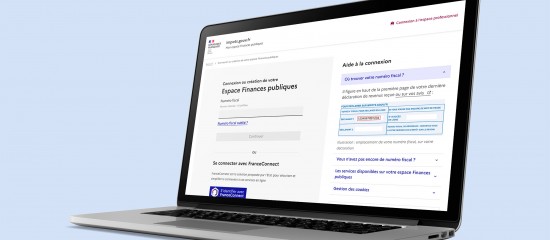
Crée le 22-01-2026
L’« espace particulier » sur impots.gouv.fr rebaptisé !
FiscalImpots sur le revenuFiscalité personnelleLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoInstagramActualitéL’espace sécurisé dont disposent en ligne les contribuables sur le site impots.gouv.fr a été récemment renommé « espace Finances publiques » et permet désormais de payer certaines factures de services publics (Ehpad, cantine scolaire, hôpital…).
Marion Beurel
Les contribuables disposent d’un espace personnel sécurisé sur le site impots.gouv.fr leur permettant d’effectuer la plupart de leurs démarches fiscales en ligne. Dans cet espace, ils peuvent, notamment, déclarer annuellement leurs revenus, mais aussi consulter leurs documents fiscaux (avis d’imposition…), payer leurs impôts (impôt sur le revenu, taxe foncière…) ou contacter les services des impôts grâce à une messagerie sécurisée. Cet espace permet aussi de gérer le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, par exemple en signalant un changement de situation familiale ou en modulant à la hausse ou à la baisse le taux de prélèvement et/ou les acomptes. D’autres services sont accessibles tels que « Biens immobiliers », qui permet aux propriétaires de locaux d’habitation de déclarer des changements d’occupation ou certains travaux.
Cet espace, auparavant dénommé « espace particulier », a récemment été rebaptisé « espace Finances publiques ». Et les services auxquels il donne accès ont également été élargis, allant au-delà des seules démarches fiscales. Ainsi, désormais, les contribuables concernés peuvent consulter et payer certaines factures de services publics locaux comme l’eau, la cantine scolaire, la crèche, les activités périscolaires, un Ehpad ou encore l’hôpital.
D’autres évolutions devraient intervenir dans les prochains mois.

Crée le 22-01-2026
Le barème 2026 de saisie des rémunérations
SocialRémunérationLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoAssociationsActualitéLes nouvelles limites de saisie des rémunérations des salariés par leurs créanciers sont fixées pour l’année 2026.
La Rédaction
Les créanciers d’un salarié peuvent engager une procédure leur permettant de saisir directement entre les mains de l’employeur une partie du salaire versé. Le montant de cette partie saisissable vient d’être réévalué. Ce nouveau barème est applicable depuis le 1 janvier 2026.
| Barème 2026 des fractions de salaires saisissables | |||
| Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) |
Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) |
Quotité saisissable | Fraction mensuelle saisissable cumulée* |
| Jusqu’à 4 480 € | Jusqu’à 373,33 € | 1/20 | 18,67 € |
| Supérieure à 4 480 € et inférieure ou égale à 8 730 € | Supérieure à 373,33 € et inférieure ou égale à 727,50 € | 1/10 | 54,08 € |
| Supérieure à 8 730 € et inférieure ou égale à 13 000 € | Supérieure à 727,50 € et inférieure ou égale à 1 083,33 € | 1/5 | 125,25 € |
| Supérieure à 13 000 € et inférieure ou égale à 17 230 € | Supérieure à 1 083,33 € et inférieure ou égale à 1 435,83 € | 1/4 | 213,37 € |
| Supérieure à 17 230 € et inférieure ou égale à 21 470 € | Supérieure à 1 435,83 € et inférieure ou égale à 1 789,17 € | 1/3 | 331,15 € |
| Supérieure à 21 470 € et inférieure ou égale à 25 810 € | Supérieure à 1 789,17 € et inférieure ou égale à 2 150,83 € | 2/3 | 572,26 € |
| Au-delà de 25 810 € | Au-delà de 2 150,83 € | en totalité | 572,26 € + totalité au-delà de 2 150,83 € |
| * Calculée par nos soins. |
|||
Attention : : il doit être laissé au salarié saisi une somme au moins égale au montant du RSA pour une personne seule sans correctif pour charges de famille, soit 646,52 € depuis le 1 avril 2025 (323,26 € à Mayotte).
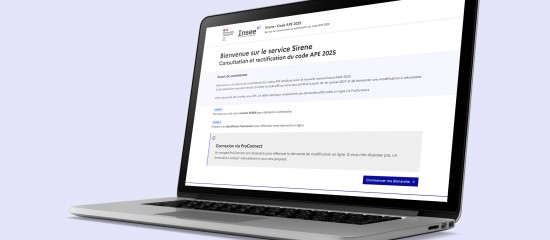
Crée le 22-01-2026
Prenez connaissance de votre nouveau code APE !
JuridiqueLe Guide du Chef d-EntrepriseFomalités/DéclarationsBoucle VidéoAssociationsActualitéLe 1 janvier 2027, les entreprises se verront attribuer un nouveau code APE. Elles peuvent d’ores et déjà le consulter en ligne.
La Rédaction
Le 1 janvier 2027, une nouvelle nomenclature d’activités française (NAF) entrera en vigueur. Établie à la suite de la mise à jour de la nomenclature des activités économiques dans l’Union européenne, avec laquelle elle partage la même structure, cette NAF nouvelle version (NAF 2025) remplacera donc celle en vigueur en France depuis 2007. Elle répond ainsi à l’émergence de nouvelles activités.
En pratique, un nouveau code APE, qui n’entrera en vigueur que le 1 janvier 2027, sera donc attribué par l’Insee aux entreprises. Sachant que ces dernières peuvent d’ores et déjà en prendre connaissance sur , ce qui leur permettra de vérifier qu’il correspond bien à leur activité principale. Pour ce faire, il leur suffit de renseigner leur numéro SIREN.
Rappel : : la nomenclature d’activités française (NAF) sert principalement à faciliter l’organisation de l’information économique et sociale en permettant le classement des activités économiques. En référence à cette nomenclature, un code correspondant à l’activité principale exercée (le fameux code APE) est attribué par l’Insee à chaque entreprise et à chaque établissement inscrit au répertoire national d’identité des entreprises (le répertoire Sirene). Composé de quatre chiffres et d’une lettre, ce code permet notamment aux administrations fiscales et sociales de connaître l’activité d’une entreprise et donc d’identifier les règlementations, la fiscalité ou encore les formalités auxquelles elle est soumise. Il doit figurer sur les bulletins de salaire émis par l’entreprise.
À noter : : au cas où ce nouveau code ne correspondrait pas à l’activité principale de l’entreprise, elle pourrait demander à le modifier. Cette demande, qui peut s’effectuer , nécessite de disposer d’un compte ProConnect. À défaut, un formulaire à remplir manuellement est proposé.

Crée le 21-01-2026
Duflot, Pinel, Denormandie : les plafonds 2026 ont été publiés
FiscalPatrimoineImmobilierAvantages fiscauxFiscalitéFiscalité personnelleLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoActualitéLes plafonds de loyers et de ressources du locataire pour les dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement immobilier locatif ont été réactualisés.
Fabrice Gomez
Les particuliers peuvent bénéficier, au titre de certains investissements immobiliers locatifs, d’avantages fiscaux. Toutefois, ces dispositifs d’incitation fiscale ne peuvent s’appliquer que sur une base plafonnée et sont, en outre, soumis à des plafonds de loyers et, le cas échéant, à des conditions tenant aux ressources du locataire qui diffèrent selon le dispositif concerné.
À ce titre, révisés chaque début année, les plafonds des dispositifs Duflot, Pinel et Denormandie (applicables aux baux conclus ou renouvelés en 2026) viennent d’être publiés.
| Plafonds mensuels de loyer par mètre carré (charges non comprises) | |||
| Zones | |||
| A bis | A | B1 | B2 et C |
| 19,71 € | 14,64 € | 11,80 € | 10,26 € |
| Plafonds annuels de ressources des locataires | ||||
| Zones | ||||
| A bis | A | B1 | B2 et C | |
| Personne seule | 44 344 € | 44 344 € | 36 144 € | 32 530 € |
| Couple | 66 276 € | 66 276 € | 48 268 € | 43 439 € |
| Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 86 878 € | 79 666 € | 58 043 € | 52 239 € |
| Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 103 727 € | 95 427 € | 70 073 € | 63 066 € |
| Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 123 415 € | 112 968 € | 82 432 € | 74 189 € |
| Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 138 874 € | 127 122 € | 92 900 € | 83 611 € |
| Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | +15 471 € | +14 164 € | +10 364 € | +9 325 € |

Crée le 16-01-2026
L’aide à la création d’entreprise devient moins généreuse
SocialCréationTransversauxAllègements exonérationsLe Guide du Chef d-EntrepriseCréation d-entrepriseBoucle VidéoActualitéDepuis le 1 janvier 2026, l’Acre bénéficie à moins de créateurs et repreneurs d’entreprise et son montant est moins élevé.
Sandrine Thomas
L’aide à la création ou à la reprise d’une entreprise (Acre) permet aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise de bénéficier d’une exonération de leurs cotisations sociales personnelles (cotisations d’assurance maladie-maternité, d’assurance vieillesse, d’assurance invalidité-décès et d’allocations familiales) pendant les 12 premiers mois de leur activité.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a réduit le champ des bénéficiaires de l’Acre et diminué le taux de l’exonération pour les cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1 janvier 2026.
Sortent du dispositif de l’Acre tous les travailleurs indépendants (autres que les micro-entrepreneurs) qui ne relèvent pas de l’une des catégories de l’article L5141-1 du Code du travail.
Désormais, peuvent ainsi bénéficier de cette exonération :- les personnes relevant de l’une des catégories de l’article L5141-1 du Code du travail (qu’ils soient ou non micro-entrepreneurs) ;- les créateurs ou repreneurs d’une entreprise implantée dans une zone France ruralités revitalisation (ZFRR ou ZFRR +) ;- et, comme avant, les conjoints collaborateurs d’un travailleur indépendant (autre qu’un micro-entrepreneur) bénéficiaire de l’Acre.
Jusqu’alors, l’exonération de cotisations sociales était totale lorsque l’entrepreneur percevait un revenu annuel inférieur ou égal à 75 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass), soit à 36 045 € en 2026.
Depuis le 1 janvier 2026, le montant de l’exonération de cotisations (qui doit encore être fixé par décret) ne peut pas dépasser 25 % de ces cotisations.
Comme auparavant, l’exonération de cotisations, qui continue de s’appliquer pendant 12 mois :- est dégressive pour un revenu supérieur à 75 % et inférieur à 100 % du Pass (48 060 € en 2026) ;- est nulle pour un revenu au moins égal au Pass.
En pratique : : la demande d’Acre doit être déposée auprès de l’Urssaf.
Précision : : relèvent de l’article L5141-1 du Code du travail notamment les demandeurs d’emploi indemnisés, les demandeurs d’emploi non indemnisés inscrits à France Travail au moins 6 mois au cours des 18 derniers mois, les bénéficiaires du RSA, les personnes âgées de 18 à moins de 26 ans, les personnes âgées de moins de 30 ans qui sont handicapées ou qui ne remplissent pas la condition de durée d’activité antérieure pour bénéficier de l’allocation chômage, les personnes salariées ou les personnes licenciées d’une entreprise en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires qui reprennent tout ou partie d’une entreprise et les personnes physiques créant ou reprenant une entreprise implantée au sein d’un quartier prioritaire de la politique de la ville.
Exception : : les exploitants agricoles continuent donc de se voir appliquer le régime de l’Acre tel que prévu jusqu’au 31 décembre 2025.

Crée le 22-01-2026
Comment sécuriser le télétravail dans les TPE-PME
MultimédiaMultiMédiaTendancesLe Guide du Chef d-EntrepriseAssociationsActualitéParce que le télétravail expose les entreprises à des risques cyber accrus, France Num propose un webinaire, le 29 janvier 2026 à 12 heures, pour apprendre aux TPE-PME qui le pratiquent à mieux se protéger.
Isabelle Capet
France Num propose régulièrement des webinaires durant lesquels des experts apportent aux entreprises des conseils avisés pour déployer au mieux le numérique, améliorer la gestion de leur entreprise et faire croître leur activité. Le prochain en date sera consacré au télétravail. S’il permet plus de flexibilité et de productivité pour les salariés, il expose également l’entreprise à plus de risques comme du hameçonnage, des fuites de données ou encore des rançongiciels.
Accessible en ligne gratuitement sur inscription, ce webinaire proposera aux TPE-PME d’en savoir plus sur comment sécuriser leurs accès, protéger leurs équipements ou encore sensibiliser leurs équipes. Il abordera également les obligations légales à respecter, les solutions économiques à mettre en œuvre et la façon de réagir en cas d’incident. Un temps d’échange permettra de répondre aux questions.
Pour en savoir plus :

Crée le 21-01-2026
Pas de report en arrière des déficits en cas de changement d’activité
AutresFiscalLe Guide du Chef d-EntrepriseJurisprudenceFiscalité des résultatsImpots sur les bénéficesFiscalité professionnelleBoucle VidéoActualitéL’option pour le report en arrière du déficit d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent n’est pas possible lorsque la société a, au cours de l’un de ces deux exercices, modifié son activité.
Marion Beurel
Une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés peut décider, sur option, de reporter en arrière le déficit constaté à la clôture d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent. On parle de « carry-back ». Un report en arrière qui ne peut jouer que dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et d’un montant de 1 million d’euros.
Cette imputation fait naître au profit de l’entreprise une créance sur l’État correspondant à l’impôt qui avait été versé sur la fraction de bénéfice couverte par l’imputation du déficit. Par la suite, cette créance peut être utilisée par l’entreprise pour payer son impôt sur les sociétés des exercices clos les 5 années suivantes. La fraction non-utilisée étant normalement remboursée à l’issue de cette période de 5 ans.
Attention toutefois, l’option pour le report en arrière des déficits ne peut pas être exercée au titre d’un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d’entreprise.
À ce titre, la question s’est posée de savoir si un changement d’activité, emportant cessation d’entreprise, fait également obstacle à l’exercice de cette option ?
Oui, a répondu le Conseil d’État, et ce peu importe que ce changement d’activité intervienne au cours de l’exercice déficitaire ou de l’exercice bénéficiaire précédent, dans la mesure où l’entreprise n’est, en réalité, plus la même.
Dans cette affaire, une SARL avait été créée en 2002 pour exercer une activité de fabrication, d’achat, de vente, d’importation et d’exportation de matériels, d’accessoires et d’outillages pour les travaux de second œuvre du bâtiment.
Fin 2012, cette SARL avait cédé son fonds de commerce, puis modifié sa dénomination et l’objet social prévu par ses statuts afin d’exercer désormais une activité de conseil et d’assistance à toute entreprise intervenant dans le domaine du bâtiment, d’expertise et de diagnostic immobiliers ainsi que d’apport d’affaires et de conseil en immobilier.
Ayant constaté un déficit au titre de l’exercice 2013, la SARL avait opté pour son report en arrière et son imputation sur le bénéfice réalisé au titre de l’exercice 2012. Puis, en 2019, elle avait demandé la restitution de la créance résultant de ce report en arrière. Mais cette demande avait été rejetée par l’administration fiscale en raison du changement d’activité survenu fin 2012. Un rejet qui vient d’être confirmé par le Conseil d’État qui a considéré que la société ne pouvait plus être regardée, lors de l’exercice déficitaire, comme la même entreprise que celle ayant réalisé le bénéfice lors de l’exercice précédent.
Précision : : la fraction de déficit qui excède le bénéfice du dernier exercice ou qui excède 1 M€, qui n’a donc pas pu être reportée en arrière, demeure reportable en avant, c’est-à-dire sur les exercices suivants.

Crée le 19-01-2026
Vente d’un local commercial conclue au mépris du droit de préférence du locataire
JuridiqueAutresContratsJurisprudenceLe Guide du Chef d-EntrepriseBail commercialBoucle VidéoAssociationsActualitéLorsque le propriétaire a vendu un local commercial sans avoir respecté le droit de préférence du locataire, ce dernier peut faire annuler la vente en agissant en justice dans un délai de 2 ans.
Christophe Pitaud
Le commerçant qui exploite un fonds de commerce dans un local loué dispose, lorsque ce local est mis en vente, d’un droit dit « de préférence » qui lui permet de l’acheter en priorité par rapport à un autre candidat à l’acquisition.
Et attention, les juges viennent de rappeler que si son droit de préférence n’a pas été respecté (soit parce qu’il n’a pas été initialement informé de l’intention du propriétaire de vendre le local, soit parce qu’il n’a pas été informé des conditions ou du prix de vente plus avantageux proposés à un acquéreur), le locataire est en droit d’obtenir en justice l’annulation de la vente.
Les juges ont également précisé que l’action du locataire en annulation de la vente conclue en violation de son droit de préférence doit être intentée dans un délai de 2 ans, à l’instar de toutes les actions exercées en vertu du statut des baux commerciaux, et non pas dans le délai de droit commun de 5 ans.
En pratique : : le propriétaire doit informer le locataire, par lettre recommandée AR, de son intention de vendre le local. Cette notification, qui doit indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée, vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre de vente pour se prononcer. Et s’il accepte d’acquérir le local, il a 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire pour réaliser la vente. Ce délai étant porté à 4 mois lorsqu’il accepte l’offre de vente sous réserve d’obtenir un prêt.Sachant que si, après que le locataire a refusé d’acquérir le local, le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et ce prix. Là aussi, cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. Si le locataire décide d’acquérir le local, il a 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire pour réaliser la vente. Ce délai étant porté à 4 mois lorsqu’il accepte l’offre de vente sous réserve d’obtenir un prêt.
Précision : : selon nous, ce délai court à compter du jour où le locataire a eu connaissance de l’existence de la vente.

Crée le 19-01-2026
Plans d’épargne logement : une vague de clôtures en approche
PatrimoineLe Guide du Chef d-EntreprisePlacementBoucle VidéoInstagramActualitéLes Plans d’épargne logement souscrits en 2011 arriveront à échéance durant l’année 2026. Une bonne occasion pour réorienter son épargne vers des produits plus rémunérateurs.
Fabrice Gomez
Lancé en 1969, le Plan d’épargne logement (PEL) a été conçu comme un produit d’épargne de moyen terme dont l’objectif est de compléter le financement d’un projet immobilier, après une phase d’épargne. Cette dernière générant des intérêts à un taux qui dépend de la date d’ouverture du plan. Étant précisé que le choix est laissé au titulaire du plan de solliciter ou non ses droits à prêt. En pratique, le PEL peut donc être utilisé comme un simple produit d’épargne même si ce n’est pas sa vocation initiale.
En termes de chiffres, à fin juin 2025, le PEL représente une réserve d’épargne de l’ordre de 208 milliards d’euros, se positionnant ainsi comme l’un des produits réglementés les plus populaires avec le Livret A, qui cumule, quant à lui, environ 404 Md€.
Contrairement à d’autres produits réglementés, le PEL ne peut pas être conservé indéfiniment. En effet, suite à un décret du 25 février 2011, les règles du jeu ont évolué : ce placement est automatiquement clôturé au bout de 15 ans à compter de la date de sa souscription.
Ainsi, les premiers PEL ouverts depuis le 1 mars 2011 arriveront à échéance cette année. Une vague de clôtures qui n’est pas sans impact. En effet, selon la Banque de France, pas moins de 3,2 millions de PEL seront fermés automatiquement entre 2026 et 2030 pour un encours total de 90 Md€.
L’arrivée de cette échéance peut être une bonne occasion pour les épargnants concernés de réorienter leur épargne. En effet, bien que le PEL permette de se constituer une épargne de précaution ou un apport pour un futur projet immobilier, son rendement (fixé à 2 % brut depuis le 1 janvier 2026) est insuffisant pour valoriser un capital. Se tourner vers d’autres solutions peut donc être opportun. On pense, par exemple, au PEA ou à l’assurance-vie, qui permettent notamment de diversifier ses investissements et d’aller chercher un potentiel de rendement, ou encore au Plan d’épargne retraite (PER) pour préparer ses vieux jours dans de bonnes conditions.
À noter : : à la clôture, le PEL est transformé en livret d’épargne classique (compte sur livret) dont le taux de rémunération est fixé par l’établissement bancaire.
Précision : : les PEL ouverts avant le 1 mars 2011 peuvent être conservés sans limitation de durée.

Crée le 15-01-2026
Formation des bénévoles : appel à projets 2026 du FDVA
JuridiqueLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableAssociationsActualitéLes associations nationales ont jusqu’au 1 mars 2026 pour demander au Fonds pour le développement de la vie associative une subvention afin de former leurs bénévoles.
Sandrine Thomas
Le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) a lancé sa campagne annuelle destinée à financer les formations des bénévoles œuvrant dans les associations.
Peuvent être financées les formations collectives bénéficiant à l’association et à son développement et destinées aux bénévoles réguliers ou à ceux sur le point de prendre des responsabilités tout au long de l’année. Sont donc exclus les bénévoles intervenant de façon ponctuelle dans l’association.
Cette année, les associations nationales peuvent répondre à l’jusqu’au 1 mars 2026 inclus. Elles doivent déposer leur demande de subvention de façon dématérialisée via le télé-service (fiche n° 3660, FDVA-sous dispositif pluriannuel).
Exceptions : : ce financement n’est pas ouvert aux associations agréées œuvrant dans le domaine des activités physiques et sportives, à celles qui défendent et/ou représentent un secteur professionnel, ni à celles qui défendent essentiellement les intérêts communs d’un public adhérent (au regard de leur objet statutaire ainsi que de leurs activités réelles de lobbying).
À noter : : les demandes de subventions nationales doivent être présentées pour 3 ans (accompagnement pluriannuel 2026-2028).

Crée le 16-01-2026
Un nouveau Code pour la TVA au 1 septembre 2026
FiscalLe Guide du Chef d-EntrepriseTVAFiscalité professionnelleBoucle VidéoAssociationsActualitéLe transfert des dispositions relatives à la TVA, qui figurent actuellement dans le Code général des impôts (CGI), vers le Code des impositions sur les biens et services (CIBS) est prévu. Mais il sera sans incidence sur les factures jusqu’à fin 2027.
Marion Beurel
Les dispositions régissant la TVA, qui figurent actuellement dans le Code général des impôts (CGI), vont basculer vers le Code des impositions sur les biens et services (CIBS) à compter du 1 septembre 2026.
Bien que cette recodification soit effectuée sans modification des règles applicables à la TVA, elle va toutefois au-delà d’une simple réorganisation des dispositions existantes. En effet, elle s’accompagne, notamment, d’un travail de réécriture et de définition du vocabulaire. Et, point important, elle intégrera certaines évolutions issues de décisions de justice. C’est pourquoi des mesures transitoires et d’accompagnement ont été prévues.
En premier lieu, les commentaires de l’administration fiscale figurant au bulletin officiel des finances publiques (Bofip), ainsi que les réponses individuelles apportées aux redevables, resteront opposables, même en l’absence de mise à jour des références juridiques ou du vocabulaire qu’ils contiennent.
En second lieu, des tableaux de correspondance entre les anciennes dispositions du CGI et les nouvelles dispositions du CIBS seront publiés.
Ce changement de Code sera sans incidence sur la généralisation de la facturation électronique, également prévue à compter du 1 septembre 2026. Les dispositions relatives à cette réforme restent donc inchangées.
Par ailleurs, les entreprises pourront continuer de mentionner les références aux anciens articles du CGI sur leurs factures jusqu’à fin 2027 afin de laisser le temps nécessaire aux mises à jour de leurs logiciels.

Crée le 16-01-2026
Violation d’une clause de non-concurrence par un agent commercial
JuridiqueAutresContratsLe Guide du Chef d-EntrepriseJurisprudenceBoucle VidéoActualitéPour pouvoir donner lieu à indemnisation, la violation d’une clause de non-concurrence par un agent commercial doit avoir causé un préjudice à l’entreprise au profit de laquelle elle a été souscrite.
Christophe Pitaud
Lorsqu’une clause de non-concurrence n’est pas respectée, l’entreprise au profit de laquelle elle a été stipulée est en droit de réclamer des dommages-intérêts. À ce titre, les juges viennent de préciser qu’une indemnisation n’est possible que si l’entreprise démontre avoir subi un préjudice en raison de la violation de la clause.
Dans cette affaire, un contrat d’agence commerciale conclu entre une entreprise et une société chargée de commercialiser ses produits dans un certain secteur géographique comportait une clause de non-concurrence post-contractuelle. Or après que ce contrat avait été résilié, l’agent commercial avait conclu un partenariat avec une société concurrente. Lui reprochant d’avoir violé son engagement de non-concurrence, l’entreprise avait alors réclamé des dommages-intérêts à l’agent commercial.
Saisie du litige, la cour d’appel avait fait droit à la demande de l’entreprise et condamné l’agent commercial à lui verser la somme de 50 000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice consécutif à la désorganisation de son réseau commercial.
Mais la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a affirmé que l’entreprise bénéficiaire d’une clause de non-concurrence qui invoque son inexécution doit établir le principe et l’étendue du préjudice dont elle demande réparation. Et dans cette affaire, elle a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si la violation de la clause de non-concurrence avait effectivement causé un préjudice à l’entreprise tenant à la désorganisation de son réseau commercial.

Crée le 15-01-2026
Vers un encadrement des loyers à l’échelle nationale ?
PatrimoineImmobilierLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoInstagramActualitéOutre sa pérennisation, une proposition de loi récente prévoit notamment d’étendre le dispositif d’encadrement des loyers aux communes volontaires confrontées à une tension du marché locatif.
Fabrice Gomez
Créé par la loi « Alur» du 14 mars 2014, l’encadrement des loyers est un dispositif destiné à maîtriser le montant des loyers dans les zones où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement. En pratique, dans les zones concernées, les bailleurs doivent fixer leur loyer dans une fourchette (comprise entre -30 % et +20 % d’un loyer de référence) définie chaque année par arrêté préfectoral. Fourchette qui tient compte notamment du type de logement, du nombre de pièces et du quartier. Dans certains cas, le bailleur peut toutefois aller au-delà de cette fourchette et demander un complément de loyer.
Globalement, environ 70 communes ont adopté ce dispositif : Paris, Bordeaux, Est Ensemble (9 villes de Seine-Saint-Denis), Grenoble Alpes Métropole (depuis le 20 janvier 2025), Lille, Hellemmes et Lomme, Lyon et Villeurbanne, Montpellier, Plaine Commune (9 villes de Seine-Saint-Denis) et 24 villes du Pays basque.
Adoptée récemment en première lecture à l’Assemblée nationale, une proposition de loi vise à pérenniser et compléter l’expérimentation de l’encadrement des loyers, qui doit prendre fin en novembre 2026. En pratique, le texte souhaite ouvrir cet encadrement à l’ensemble des communes volontaires en zones tendues (aujourd’hui ces communes sont listées par décret) et aux communes volontaires hors zones tendues mais confrontées à une tension du marché locatif.
En outre, la proposition de loi prévoit notamment :- de plafonner le complément de loyer à 20 % du loyer de référence majoré, tout en précisant ses critères d’interdiction ;- dans les secteurs géographiques où le niveau de loyer médian est supérieur de 10 % au niveau du loyer médian de l’agglomération pour les mêmes catégories de logements, de plafonner le loyer de référence majoré serait à un montant supérieur de 10 % au loyer de référence ;- de supprimer le délai de 3 mois après la signature du bail pour contester le complément de loyer ;- d’étendre l’action en réévaluation du loyer en cas de reconduction tacite ;- d’augmenter le montant des amendes en cas de non-respect de l’encadrement des loyers ;- d’obliger les professionnels qui contribuent à la mise en location d’un logement à informer les propriétaires des règles d’encadrement des loyers ;- d’éviter le contournement de l’encadrement des loyers par les activités de coliving ou de colocation et de supprimer l’exception dont bénéficient certains meublés de résidences avec services (prestations para-hôtelières).
Précision : : le complément de loyer est une option du dispositif d’encadrement des loyers, qui permet au bailleur de demander, outre le loyer de base, une somme supplémentaire lorsque le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant (par exemple, vue sur un monument historique, présence d’un jardin ou d’une terrasse, équipement luxueux…), par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.
Proposition de loi n° 2039, enregistrée à l’Assemblée nationale le 28 octobre 2025

Crée le 13-01-2026
Renforcement du dispositif national de cybersécurité
MultimédiaLe Guide du Chef d-EntrepriseTendancesMultiMédiaBoucle VidéoAssociationsActualitéFace à une menace cyber en constante évolution, la mise en place de centres de réponse à incident (CSIRT), notamment territoriaux et sectoriels, permet d’améliorer les actions de prévention, de détection et d’assistance.
Isabelle Capet
Issus du plan France Relance 2021, les CSIRT territoriaux (Computer Security Incident Response Team) permettent d’apporter des réponses aux incidents cyber émanant des PME, des ETI, des collectivités territoriales et des associations implantées sur leurs territoires. Ils fournissent ainsi localement un service de premier niveau gratuit et personnalisé, complémentaire de celui proposé par des prestataires, la plate-forme Cybermalveillance.gouv.fr ou les services du CERT-FR. Le dispositif est, à ce jour, constitué de 14 CSIRT territoriaux.
Des CSIRT sectoriels ont été ajoutés. Ces centres de réponse aux incidents cyber sont associés à un secteur d’activité spécifique (santé, portuaire, maritime, aéronautique, défense…). Ils traitent les demandes d’assistance des acteurs de leur secteur. Enfin, des CSIRT ministériels analysent la menace pesant sur les systèmes d’information ministériels, complétant ainsi le dispositif de cybersécurité de l’État.
Pour en savoir plus :

Crée le 14-01-2026
Nouvelle flambée des malus automobiles en 2026
PatrimoineFiscalTaxes diversesLe Guide du Chef d-EntrepriseFiscalité personnelleFiscalitéFiscalité professionnelleBoucle VidéoAssociationsActualitéLes malus susceptibles de s’appliquer lors de l’achat d’un véhicule de tourisme neuf sont revus à la hausse pour 2026 tandis que la taxation de certains véhicules d’occasion est reportée à 2027.
Marion Beurel
Les malus dus lors de l’achat d’un véhicule de tourisme neuf considéré comme polluant par les pouvoirs publics sont, une nouvelle fois, alourdis. Ainsi, depuis le 1 janvier 2026, le malus CO2 (norme WLTP) se déclenche, pour un tarif de 50 €, à partir de 108 g de CO2/km (au lieu de 113 g auparavant) et la dernière tranche du barème s’applique au-delà de 191 g de CO2/km pour un tarif de 80 000 € (contre 192 g et 70 000 € précédemment).
En outre, chaque tranche du barème progressif du malus au poids est abaissée de 100 kg, ramenant son seuil de déclenchement de 1,6 à 1,5 tonne. Son tarif par tranche reste inchangé et varie donc entre 10 et 30 € par kg pour la fraction du poids excédant 1,5 tonne.
La hausse de ces malus est toutefois neutralisée pour les véhicules d’au moins 8 places assises détenus par des sociétés grâce à une augmentation de l’abattement dont ils bénéficient sur leurs émissions de CO2 et sur leur poids.
Par ailleurs, s’agissant du malus au poids, à partir du 1 juillet 2026, une distinction sera opérée entre les véhicules 100 % électriques à faible empreinte carbone, qui seront totalement exonérés, et les autres, qui bénéficieront d’un abattement de 600 kg sur leur poids.
Les malus automobiles peuvent s’appliquer, selon des modalités spécifiques, à certains véhicules d’occasion, notamment à ceux précédemment immatriculés à l’étranger et importés en France ainsi qu’aux véhicules exonérés du fait de leurs caractéristiques (transport de marchandises, accessibilité en fauteuil roulant…) qui ont été transformés de sorte que l’exonération ne leur est plus applicable.
À ce titre, la loi de finances pour 2025 avait prévu d’étendre l’application de ces malus à davantage de véhicules d’occasion initialement non taxés (véhicules d’au moins 8 places détenus par les sociétés totalement exonérés du fait des abattements, véhicules des personnes titulaires d’une carte d’invalidité…), et ce à compter du 1 janvier 2026.
Cependant, compte tenu de l’importance des changements à apporter aux systèmes d’immatriculation des véhicules, le projet de loi de finances pour 2026 a prévu un report de cette mesure au 1 janvier 2027. Faute d’adoption de cette loi en fin d’année dernière, l’administration fiscale a toutefois admis le maintien des règles antérieures jusqu’à la date qui sera fixée dans une loi à venir. À suivre…
À savoir : : prévue par la loi de finances pour 2025, cette trajectoire haussière se poursuivra en 2027, avec un seuil de déclenchement qui sera abaissé à 103 g et une dernière tranche qui sera applicable au-delà de 189 g pour un tarif de 90 000 €.
À noter : : le cumul de ces deux malus ne peut pas excéder 80 000 €.
Nouveauté : : les véhicules de la catégorie N1, dont la carrosserie est de type « Camion » et qui sont classés hors route avec au moins 5 places assises, sont concernés par les malus auto à compter du 1 janvier 2026.
Précision : : à partir de 2027, l’abattement de 100 kg sur le malus au poids, qui profite en principe aux véhicules hybrides non rechargeables de l’extérieur et à ceux rechargeables de l’extérieur dont l’autonomie en mode tout électrique en ville n’excède pas 50 km, sera réservé aux véhicules dont la puissance maximale nette du moteur électrique est d’au moins 30 kilowatts.

Crée le 12-01-2026
Paiement fractionné ou différé des droits de succession : le taux d’intérêt 2026 est connu
PatrimoineFiscalFamilleLe Guide du Chef d-EntrepriseFiscalité personnelleFiscalitéBoucle VidéoActualitéLes héritiers peuvent demander à l’administration fiscale d’acquitter les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière dont ils sont redevables de manière différée ou fractionnée moyennant paiement d’intérêts à un taux de 2 % en 2026.
Fabrice Gomez
Les héritiers peuvent solliciter auprès de l’administration fiscale un paiement fractionné ou différé des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière dont ils sont redevables.
Mais attention, en contrepartie de cette « facilité de paiement », les héritiers sont redevables d’intérêts dont le taux est défini chaque année. Ainsi, pour les demandes de « crédit » formulées depuis le 1 janvier 2026, le taux est fixé à 2 % (2,3 % en 2025). Un taux abaissé à 0,6 % (0,7 % en 2025) pour certaines transmissions d’entreprises.
Précision : : le paiement fractionné consiste à acquitter les droits d’enregistrement en plusieurs versements égaux étalés, en principe, sur une période d’un an maximum (3 versements espacés de 6 mois). Le paiement différé ne peut, quant à lui, être utilisé que pour les successions comprenant des biens démembrés. Les droits de succession correspondant à la valeur imposable de la nue-propriété sont alors acquittés dans les 6 mois suivant la réunion des droits démembrés (au décès du conjoint survivant) ou la cession partielle ou totale de leurs droits.
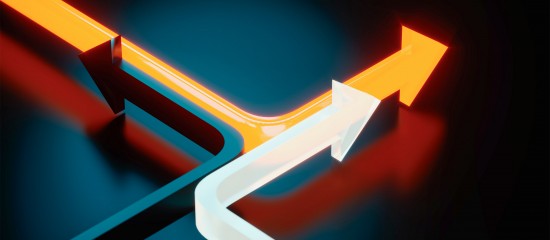
Crée le 12-01-2026
Cession de parts sociales : conditions de validité d’une clause de non-concurrence
JuridiqueAutresSociétésDroits des sociétésContratsLe Guide du Chef d-EntrepriseJurisprudenceBoucle VidéoActualitéUne clause de non-concurrence souscrite par un associé lorsqu’il cède ses parts sociales doit prévoir une contrepartie financière dès lors que ce dernier est également salarié de la société au moment où il souscrit l’engagement de non-concurrence.
Christophe Pitaud
Comme son nom l’indique, une clause de non-concurrence a pour objet de préserver une entreprise contre une éventuelle concurrence d’un partenaire avec lequel elle est en relation d’affaires ou d’un ancien dirigeant, d’un ancien associé ou d’un ancien salarié. Une telle clause est donc très souvent présente dans certains contrats tels que la vente de fonds de commerce, la location-gérance, la franchise, l’agence commerciale, la cession de clientèle ou encore la cession de parts sociales ou d’actions. Et bien entendu, dans les contrats de travail.
Mais attention, pour être valable, une clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l’espace et être proportionnée aux intérêts de la société. Sachant que dans le cadre d’une cession de parts sociales, elle n’a pas à prévoir de contrepartie financière au profit du cédant. À moins que ce dernier ne soit également salarié de la société au jour où il souscrit l’engagement de non-concurrence. Dans ce cas, une contrepartie financière à cet engagement est obligatoire.
C’est ce que les juges ont, une nouvelle fois, rappelé dans l’affaire récente suivante. Le 18 décembre 2014, une salariée d’une société en était devenue associée. Elle avait alors signé un pacte d’associés comportant une clause de non-concurrence à la charge des associés. Le 6 septembre 2019, elle avait démissionné de son emploi salarié, puis, le 13 décembre suivant, elle avait cédé ses parts sociales. Elle avait alors été embauchée par une entreprise concurrente.
Ayant estimé que l’intéressée avait violé la clause de non-concurrence, la société lui avait réclamé le paiement de la pénalité prévue par celle-ci. Mais pour sa défense, l’ex-salariée avait fait valoir que la clause de non-concurrence n’était pas valable puisqu’elle ne prévoyait pas de contrepartie financière.
Saisie du litige, la cour d’appel avait donné gain de cause à la société puisque, selon elle, l’ex-associée avait expressément admis, lors de la signature de l’acte de cession de ses parts sociales le 13 décembre 2019, que la contrepartie de la clause de non-concurrence était comprise dans le prix de cession des parts et qu’elle ne pouvait donc plus en contester la validité.
Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. En effet, elle a rappelé que la validité d’une clause de non-concurrence mise à la charge des associés d’une société est subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière lorsque ces associés avaient, à la date de leur engagement de non-concurrence, la qualité de salarié de la société. La Cour de cassation a donc reproché à la cour d’appel de ne pas avoir recherché s’il y avait bien une contrepartie réelle à la clause de non-concurrence souscrite par l’intéressée.

Crée le 09-01-2026
FDVA formation Certif’Asso : appel à projets national 2026
JuridiqueLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableAssociationsActualitéLes associations nationales qui ont obtenu l’autorisation préfectorale Certif’Asso ont jusqu’au 15 mars 2026 pour demander une subvention au Fonds pour le développement de la vie associative.
Sandrine Thomas
Le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) a lancé une campagne destinée à financer les formations des bénévoles via le Certif’Asso. Cet est ouvert uniquement aux associations qui ont obtenu l’autorisation préfectorale Certif’Asso et qui proposent des modules de formation Certif’Asso se déroulant entre le 1 janvier 2026 et le 31 décembre 2028.
Pour avoir droit à une subvention, les associations doivent :- proposer des formations gratuites ou exiger une contribution modeste ;- mettre en place des modules de formation accueillant entre 8 et 20 bénévoles ;- ouvrir ces modules à tout public bénévole (dirigeants ou futurs dirigeants) quel que soit le secteur d’activité.
Les associations nationales peuvent répondre à l’appel à projets jusqu’au 15 mars 2026 inclus. Elles doivent déposer leur demande de subvention de façon dématérialisée via le télé-service (fiche n° 3999, sous dispositif Certif’Asso).

Crée le 09-01-2026
La limite d’exonération des titres-restaurant en 2026
SocialAllègements exonérationsLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoAssociationsActualitéDepuis le 1 janvier 2026, la contribution patronale finançant les titres-restaurant est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 7,32 €.
La Rédaction
La contribution de l’employeur au financement des titres-restaurant distribués aux salariés est exonérée de cotisations sociales dans une certaine limite.
Pour les titres-restaurant distribués aux salariés à compter du 1 janvier 2026, cette contribution patronale bénéficie d’une exonération de cotisations sociales dans la limite de 7,32 € par titre (contre 7,26 € en 2025).
Rappelons que, de manière exceptionnelle, les salariés sont autorisés, jusqu’au 31 décembre 2026, à utiliser leurs titres-restaurant pour payer tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable (riz, pâtes, farine, œufs, céréales, beurre, viande ou poisson non transformés...), à l’exclusion cependant de l’alcool, des confiseries, des produits infantiles et des aliments pour animaux.
Précision : : pour être exonérée de cotisations sociales, la contribution de l’employeur aux titres-restaurant doit être comprise entre 50 % et 60 % de la valeur du titre. La valeur du titre-restaurant ouvrant droit à l’exonération maximale de 7,32 € est donc comprise entre 12,20 € et 14,64 €.

Crée le 09-01-2026
Les tarifs des annonces légales en hausse en 2026
TransversauxJuridiqueCréationDroits des sociétésCréation d-entrepriseDéfaillance d-entrepriseFomalités/DéclarationsLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoActualitéEn 2026, les tarifs des annonces légales facturées au caractère augmentent légèrement de même que celui des annonces légales faisant l’objet d’une tarification au forfait.
La Rédaction
Les tarifs de publication des annonces légales ont été fixés pour 2026. Rappelons que désormais ces tarifs sont déterminés selon le nombre de caractères que comporte l’annonce et non plus en fonction du nombre de lignes. Et ils varient selon les départements. Un certain nombre d’annonces sont toutefois facturées au forfait.
En augmentation par rapport à 2025, le tarif HT du caractère est fixé en 2026 à :- 0,195 € dans les départements de l’Aisne, de l’Ardèche, des Ardennes, de la Drôme, de l’Isère, de l’Oise, du Rhône, de la Somme et de l’Yonne ;- 0,206 € dans les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime ;- 0,227 € dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise ;- 0,239 € à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;- 0,185 € en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Wallis-et-Futuna ;- 0,210 € à La Réunion et à Mayotte.
Il est fixé à 0,189 € dans tous les autres départements.
Les avis de constitution des sociétés sont, quant à eux, facturés selon un forfait. Ce forfait augmente aussi en 2026. Il est fixé comme suit :- société anonyme (SA) : 399 € (466 € à La Réunion et à Mayotte) ;- société par actions simplifiée (SAS) : 199 € (233 € à La Réunion et à Mayotte) ;- société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) : 142 € (167 € à La Réunion et à Mayotte) ;- société en nom collectif (SNC) : 220 € (259 € à La Réunion et à Mayotte) ;- société à responsabilité limitée (SARL) : 148 € (173 € à La Réunion et à Mayotte) ;- entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) : 124 € (147 € à La Réunion et à Mayotte) ;- société civile (à l’exception des sociétés civiles à objet immobilier) : 222 € (263 € à La Réunion et à Mayotte) ;- société civile à objet immobilier (SCI) : 191 € (223 € à La Réunion et à Mayotte).
Les annonces concernant les modifications statutaires suivantes (en augmentation par rapport à 2025) sont facturées comme suit en 2026 :- nomination et cessation de fonction du commissaire aux comptes des sociétés commerciales et civiles ; modification de la durée des sociétés commerciales et civiles ; transfert du siège des sociétés commerciales (y compris les SE) et civiles ; nomination et cessation de fonction des dirigeants des sociétés commerciales et civiles : 109 € (126 € à La Réunion et à Mayotte) ;- changement de l’objet social (sociétés commerciales et civiles) ; nomination d’un administrateur judiciaire dans les sociétés commerciales et les sociétés civiles ; modification du capital des sociétés commerciales et civiles : 136 € (158 € à La Réunion et à Mayotte) ;- transformation des sociétés commerciales (y compris transformation d’une SA en SE ou d’une SE en SA) et des sociétés civiles ; mouvements d’associés des sociétés commerciales, des sociétés civiles et des associations d’avocats ; changement de la dénomination des sociétés commerciales et civiles : 199 € (229 € à La Réunion et à Mayotte) ;- décision des associés de ne pas dissoudre une SARL ou une société par actions en cas de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social : 83 € (93 € à La Réunion et à Mayotte).
Enfin, les annonces concernant les liquidations de société (en augmentation par rapport à 2025, à une exception près) sont facturées comme suit en 2026 :- acte de nomination des liquidateurs amiables des sociétés civiles et commerciales : 153 € (181 € à La Réunion et à Mayotte) ;- avis de clôture de la liquidation amiable des sociétés commerciales et civiles : 111 € (129 € à La Réunion et à Mayotte) ;- jugement d’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires, rétablissement professionnel) : 66 € (78 € à La Réunion et à Mayotte) ;- jugement de clôture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires, rétablissement professionnel) : montant inchangé à 36 € (42 € à La Réunion et à Mayotte).
Comme auparavant :- une réduction de 50 % s’applique pour les annonces publiées dans le cadre d’une procédure collective, sauf celles relatives aux jugements d’ouverture et de clôture de la procédure, et pour les annonces faites dans le cadre du transfert universel du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel ;- une réduction de 70 % s’applique pour les annonces faites par des personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle.
Précision : : le coût des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation en commun (Gaec) et des sociétés d’une autre forme que celles mentionnées ci-dessus (notamment, les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite par actions et les sociétés d’exercice libéral) reste fixé au nombre de caractères, selon le tarif de droit commun.
Attention : : les annonces relatives à plus d’une des modifications de cette liste font l’objet d’une tarification au caractère.

Crée le 09-01-2026
Frais bancaires de succession : le plafond 2026 est connu
PatrimoineFamilleLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoActualitéPour 2026, les banques ne peuvent pas facturer plus de 857 € de frais pour les opérations réalisées sur les comptes bancaires et les placements dépendant d’une succession.
Fabrice Gomez
En cas de décès d’un de leurs clients, et donc à l’ouverture de sa succession, les banques doivent effectuer plusieurs opérations : gel des avoirs, échanges avec le notaire, désolidarisation éventuelle des comptes joints, transfert de l’argent aux héritiers... Des opérations que les banques facturent : on parle couramment de frais bancaires de succession. Ces frais étaient fixés librement par chaque établissement jusqu’au 13 novembre 2025.
Depuis cette date, les frais appliqués par les banques à cette occasion sont encadrés. En effet, ils ne doivent pas dépasser 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt, avec un plafond maximum de 850 €. À noter que le montant de ce plafond est revalorisé, chaque année, par décret en tenant compte de l’inflation. Pour 2026, ce plafond s’établit à 857 €.
Rappelons que ce dispositif d’encadrement prévoit la gratuité des opérations bancaires (par exemple, clôture de comptes, évaluation des avoirs du conjoint survivant...) dans trois cas :- pour les successions les plus modestes, à savoir lorsque le solde total des comptes et produits d’épargne du défunt est inférieur à 5 965 € (5 910 € en 2025) ;- pour les successions des comptes et produits d’épargne détenus par des enfants mineurs décédés, sans condition de montant ;
- pour les successions les plus simples, c’est-à-dire lorsque le ou les héritiers produisent un acte de notoriété ou une attestation signée pour l’ensemble des héritiers à la banque lors des opérations liées à la succession, peu importe le solde des comptes. Ces opérations ne devront toutefois pas présenter de complexité manifeste (absence d’héritiers en ligne directe, présence d’un contrat immobilier en cours, compte professionnel...).

Crée le 08-01-2026
Créance de CIR : le remboursement immédiat est-il obligatoire pour une PME ?
AutresFiscalJurisprudenceLe Guide du Chef d-EntrepriseImpots sur les bénéficesFiscalité professionnelleAvantages fiscauxBoucle VidéoActualitéSelon les juges de la Cour administrative d’appel de Toulouse, la demande de remboursement immédiat d’une créance de crédit d’impôt recherche (CIR) dont bénéficie une PME constitue une simple faculté.
Marion Beurel
Les entreprises qui réalisent des opérations de recherche peuvent bénéficier, par année civile, d’un crédit d’impôt égal, en principe, à 30 % de la fraction des dépenses éligibles n’excédant pas 100 M€ (5 % au-delà). Les opérations d’innovation effectuées par les PME peuvent ouvrir droit, quant à elles, à un crédit d’impôt égal, en principe, à 20 % des dépenses éligibles, retenues dans la limite globale de 400 000 € par an.
En pratique, le crédit d’impôt recherche (CIR), de même que le crédit d’impôt innovation (CII), est imputé, sans limitation, sur l’impôt sur les bénéfices dû par l’entreprise au titre de l’année de réalisation des dépenses considérées. L’excédent de crédit d’impôt qui n’a pas pu être imputé constitue une créance sur l’État au profit de l’entreprise. Créance qui peut être utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre des 3 années suivantes. La fraction non utilisée à l’issue de cette période étant remboursée, sur demande. Toutefois, certaines entreprises peuvent bénéficier d’un remboursement immédiat de leur créance de CIR, notamment les PME (effectif < 250 salariés et chiffre d’affaires < 50 M€ ou total du bilan < 43 M€).
À ce titre, la question s’est posée de savoir si ce droit au remboursement immédiat revêt un caractère obligatoire ?
Non, ont répondu les juges de la Cour administrative d’appel de Toulouse. Selon eux, une PME a le choix et peut donc soit solliciter le remboursement immédiat de sa créance de CIR, soit faire une demande de remboursement à l’expiration de la période d’imputation de 4 ans, comme les autres entreprises.
À noter : : peuvent également demander cette restitution immédiate les entreprises nouvelles, les jeunes entreprises innovantes et les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.
Prudence : : cette solution étant inédite, une confirmation par le Conseil d’État est vivement attendue afin d’en sécuriser l’application.
Cour administrative d’appel de Toulouse, 5 juin 2025, n° 23TL02231

Crée le 05-01-2026
Quelle est la limite d’exonération des cadeaux et bons d’achat en 2026 ?
SocialAllègements exonérationsLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoAssociationsActualitéPour échapper aux cotisations sociales, la valeur des cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés ne doit pas dépasser 200 € en 2026.
La Rédaction
En théorie, les cadeaux et bons d’achats alloués aux salariés par le comité social et économique (CSE) ou, en l’absence de comité, par l’employeur, sont soumis aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS. Mais en pratique, l’Urssaf fait preuve de tolérance…
Ainsi, les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés échappent aux cotisations sociales lorsque le montant global alloué à chaque salarié sur une même année civile ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale. Une limite qui s’élève ainsi, pour 2026, à 200 € (contre 196 € en 2025).
Si ce seuil est dépassé, un cadeau ou un bon d’achat peut quand même être exonéré de cotisations sociales. Mais à certaines conditions seulement. Il faut, en effet, que le cadeau ou le bon d’achat soit attribué en raison d’un évènement particulier : naissance, mariage, rentrée scolaire, départ en retraite, etc. En outre, sa valeur unitaire ne doit pas excéder 200 €. Enfin, s’il s’agit d’un bon d’achat, celui-ci doit mentionner la nature du bien qu’il permet d’acquérir, le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’un ou plusieurs magasins spécialisés (bon multi-enseignes).
Et attention, car à défaut de respecter l’ensemble de ces critères, le cadeau ou le bon d’achat est assujetti, pour la totalité de sa valeur, aux cotisations sociales !
Précision : : un bon d’achat ne peut pas être échangeable contre du carburant ou des produits alimentaires, à l’exception des produits alimentaires courants dits « de luxe » dont le caractère festif est avéré.

Crée le 07-01-2026
Avis et notations en ligne des professionnels
MultimédiaLe Guide du Chef d-EntrepriseTendancesMultiMédiaBoucle VidéoAssociationsActualitéAlors que les évaluations en ligne des professionnels se généralisent, la CNIL propose un récapitulatif du cadre légal qui s’applique en la matière et des garanties permettant de protéger sa réputation et ses droits.
Isabelle Capet
Les personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou libérale peuvent voir leurs coordonnées figurer sur internet sans leur accord (annuaires, moteurs de recherche...), avec la possibilité pour les internautes de faire figurer des notations et des commentaires sur eux. La CNIL rappelle que si ces avis sont par principe autorisés, ils doivent tout de même respecter certaines règles. Ils ne peuvent notamment pas porter une atteinte disproportionnée aux droits et aux intérêts des professionnels.
Ces sites doivent également permettre aux professionnels de ne plus figurer sur le service d’avis et de notation, notamment lorsque les commentaires négatifs affectent gravement leur activité ou lorsqu’ils ne peuvent pas répondre librement (par exemple, un médecin ou un avocat qui ne peut pas répondre à cause du secret professionnel). Autre garantie obligatoire : les éditeurs doivent informer clairement les professionnels sur les modalités de publication, de modération et de traitement des avis figurant sur leur site. La CNIL rappelle également qu’en cas de non-respect de leurs droits, les professionnels peuvent déposer une réclamation devant elle.
Pour en savoir plus :

Crée le 07-01-2026
DPE 2026 : certains logements pourront être remis sur le marché locatif
PatrimoineImmobilierLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoInstagramActualitéGrâce à une évolution récente de la méthode de calcul du diagnostic de performance énergétique, certains logements, chauffés à l’électricité, sortent de la catégorie « passoire énergétique ».
Fabrice Gomez
Depuis le 1 janvier 2026, la méthode de calcul du diagnostic de performance énergétique (DPE) évolue. Concrètement, le coefficient de conversion de l’électricité, actuellement fixé à 2,3, est abaissé à 1,9. Comme l’indiquent les pouvoirs publics, ce changement vise à corriger une inégalité de traitement pénalisant l’électricité, énergie fortement décarbonée, au profit du gaz ou du fioul. Il permet ainsi d’améliorer le DPE de certains logements chauffés à l’électricité.
En pratique, ce sont environ 850 000 logements qui devraient quitter le statut de passoire énergétique sur les 4,8 millions de passoires recensées. Une bonne nouvelle pour certains propriétaires bailleurs qui pourront mettre (ou remettre) sur le marché locatif leur logement sans avoir de travaux coûteux à réaliser. Une bonne nouvelle également pour les bailleurs dans leur ensemble puisque cette évolution de la méthode de calcul pourrait valoriser leurs biens en leur faisant gagner une classe du DPE. Sachant qu’un gain de classe peut représenter plusieurs milliers d’euros de plus-value.
À noter que les DPE antérieurs à 2026 restent valables et peuvent, le cas échéant, être mis à jour gratuitement, sans nouvelle visite du diagnostiqueur, sur le
Rappel : : la législation interdit à la location les logements situés en France métropolitaine dont le diagnostic de performance énergétique correspond à la lettre G. Étant précisé que cette interdiction des biens les plus énergivores sur le marché locatif concernera les logements classés F à compter de 2028 et les logements classés E à compter de 2034.